«La situation des réfugiés en Grèce n’a jamais été aussi catastrophique»
- Amèle Debey

- 21 juin 2022
- 9 min de lecture
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre de réfugiés à travers le monde a atteint le triste record historique de 100 millions. Tandis que la solidarité et l’entraide se mettent en place, des voix s’élèvent pour accuser les pays refuges de pratiquer le deux poids deux mesures. En Grèce, la différence de traitement entre les Ukrainiens et les réfugiés d’autres pays est flagrante. L’Impertinent s’est rendu sur place afin de tenter de comprendre pourquoi et surtout comment. Deuxième opus de notre reportage à Athènes.

© A.D
Le mois dernier, un rapport cosigné par trois ONG (Save the children, Oxfam et Greek council for refugees) dénonçait le système d’accueil à deux vitesses en vigueur actuellement en Grèce. On peut notamment y lire: «La réaction à l'égard des réfugiés ukrainiens contraste fortement avec l'approche du gouvernement grec à l'égard des demandeurs d'asile d'autres pays, qui continue à se définir par des obstructions à l'accès à l'asile, un accueil inadéquat et des refoulements violents, conformément à une politique de dissuasion aux frontières extérieures de l'UE.»
«Le ministère de la Migration en charge du système d’asile dit depuis des années qu’il est difficile de gérer toutes ces arrivées, d’avoir les infrastructures et le personnel nécessaires, qu’il y a des problématiques techniques à prendre en compte. Et puis tout d’un coup, tout devient hyper efficace, explique Kleio Nikolopoulou, avocate au sein du Greek council for refugees. Il y a une plateforme en ligne qui marche parfaitement bien pour que les réfugiés ukrainiens puissent prendre leur rendez-vous en moins de temps qu’il en faut pour le dire.»

Au 19 avril, le ministère de la Protection des citoyens dénombrait 21’028 arrivées d’Ukrainiens en Grèce. «Ce chiffre représente plus du double du nombre total de réfugiés et de migrants arrivés en Grèce en 2021 (9’157 personnes) et plus qu'en 2020 (avec 14’785 personnes)», peut-on encore lire dans le rapport. Pourtant, les Ukrainiens – qui sont au bénéfice d’un statut de protection temporaire accordé par l’UE – ont un accès immédiat au marché du travail, aux soins médicaux, ainsi qu’à un soutien gouvernemental pour la nourriture et le transport.
Deux poids deux mesures
Cette différence d’approche a notamment été incarnée par le ministre des Migrations, Notis Mitarachi, qui a qualifié les Ukrainiens de «vrais réfugiés» le 1er mars, lors d’un débat au parlement, instaurant de fait un antagonisme avec les autres nationalités. «C’est une question politique qui ressort vigoureusement dans la rhétorique du gouvernement. Cela a immédiatement créé une division entre les gens qui viennent de différentes parties du monde, réagit Kleio. Supposément, nous partageons des valeurs, une culture et une religion similaires avec les Ukrainiens, qui sont également orthodoxes. Il y a une grande communauté grecque à Marioupol. Mais je ne vois pas comment cela peut expliquer une telle différence de traitement.»
Entre deux gorgées de son freddo expresso, café glacé très prisé sous ce climat méditerranéen, la jeune femme explique encore comment le camp de Seres, rempli de réfugiés multinationaux, a été vidé pour accueillir des Ukrainiens. Ses occupants initiaux, eux, ont été déplacés dans une partie plus marginalisée et moins confortable du camp.
Cependant, la plupart de ces nouveaux migrants du Nord n’ont pas eu besoin de requérir l’aide de l’Etat pour se loger. La grande majorité vivent avec des amis, des membres de la famille ou des proches locaux.
«Le gouvernement veut décourager les réfugiés de venir en Grèce»
Depuis de nombreuses années – et notamment lors de la crise migratoire de 2015 – la Grèce est une terre d’accueil, un point de passage. Si, au début, la solidarité de la population a pris le dessus, celle-ci s’est essoufflée et les atermoiements des pays membres de l’Union européenne ont fini par avoir raison de la patience des Grecs et de leurs dirigeants, qui semblent prendre plaisir à complexifier les diverses procédures. «Le gouvernement veut décourager les réfugiés de venir en Grèce en leur montrant à quel point c’est la merde», me souffle une observatrice aguerrie de la situation juridique du pays.
Parcours semé d’embûches
Lorsque les voyageurs arrivent à la frontière grecque, c’est soit par la mer, par la terre ou par la rivière Evros. Ils doivent immédiatement se présenter aux autorités afin d’être enregistrés dans le système et d’entrer dans la procédure, à la suite de quoi ils reçoivent un papier pourvu d’un numéro d’identification. Ensuite, leur sort sera statué par le service dévolu à cet effet. Si leur demande d’asile est refusée, ils ont la possibilité de faire appel. En cas de second refus, ils doivent alors se lancer dans un combat juridique pour faire annuler cette seconde décision. Selon les différentes associations interrogées, le gouvernement est censé financer ces deux premières étapes d’un véritable parcours du combattant.
L’un des problèmes, c’est que tous les migrants ne passent pas forcément par les points d’entrée aux frontières et certains ne sont donc pas enregistrés dans le système. A leur arrivée à Athènes, ils se retrouvent donc dans l’impossibilité de déposer leur demande et se voient conseiller de retourner à la frontière pour récupérer leur papier d'immatriculation. «On a eu des cas de gens à qui les employés des bureaux de demande d’asile ont dit de se rendre à la police pour se faire détenir administrativement dans un centre de détention pré-exclusion, explique l’avocate de Greek council for refugees. La police leur répond que ce n’est pas leur job. Tout le monde se renvoie la balle.»
Le sommet de l’horreur
En fait, les arrivées de migrants en Grèce ont drastiquement baissé ces dernières années, comme on l’a vu plus haut. Entre janvier et mai dernier, ils n’étaient que 3'500 (en dehors des Ukrainiens). Si le Covid a largement contribué à freiner les mouvements de population, l’autre explication à cette accalmie de façade se trouve dans les pushbacks (qu’on pourrait traduire par refoulements).
Les autorités grecques sont régulièrement accusées d’empêcher les migrants d’atteindre les côtes et de les repousser vers la Turquie, en parfaite violation des Droits de l’homme et malgré les sermons de l’Union européenne.
«Depuis mars 2020, nous avons reçu un nombre croissant de rapports sur des refoulements présumés, tant à la frontière terrestre qu'à la frontière maritime, explique Stella Nanou, responsable communication du bureau athénien du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Nous avons documenté plus de 540 de ces pushbacks en deux ans. Ce qui nous inquiète énormément. Pour chacun de ces cas, nous avons triangulé les preuves et tenté de contacter les victimes. Nous avons demandé aux autorités grecques d’enquêter et de prendre des actions immédiates. Certains des rapports font état de violence, de sérieuses violations des droits de l’homme. Il nous a également été rapporté des cas de pushbacks à plusieurs kilomètres de la frontière. Des gens arrêtés et ramenés en Turquie alors qu’ils étaient à l’intérieur du pays.»
«Un des traducteurs de Frontex a été impliqué dans ces pushbacks»
Comme le confirme la jeune femme, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) était non seulement au courant de ces manœuvres, mais y a participé. «Le HCR est le coprésident du Forum consultatif de Frontex sur les droits fondamentaux, un organe indépendant qui conseille Frontex sur les questions de protection des réfugiés et de droits fondamentaux. Le Forum a souligné à plusieurs reprises les lacunes du mécanisme de rapport d'incidents graves de Frontex. Un de ses traducteurs a été impliqué dans ces pushbacks. Ce cas est actuellement sous enquête.»
Pire, la Grèce est même accusée d’utiliser d’autres migrants pour effectuer ces refoulements, comme le dénonçait en avril dernier un rapport de Human rights watch.
Malgré ces nombreuses dénonciations et autres actions en justice, le gouvernement grec fait la sourde oreille. Du côté de Frontex, le directeur a démissionné récemment.
Une aide à double tranchant
Depuis le début de la crise migratoire, l’Union européenne n’a cessé de distribuer des millions d’euros à la Grèce. Mais cette aide a un goût de pis-aller. «L’union européenne a été très généreuse envers la Grèce. Des avancées positives ont été remarquées. Elle a donné beaucoup de fonds, mais lorsqu’on parle de partage des responsabilités, cela va au-delà des fonds», déclare Stella Nanou.
Non seulement peut-on peut citer le fait que la Grèce a utilisé les fonds de l’union européenne pour durcir l’entrée des réfugiés plutôt que pour faciliter leur intégration, mais en plus, les accords de l’UE avec la Turquie et la Grèce sont en contradiction avec ceux des deux pays entre eux et ajoutent à la confusion.
«Dès 2016, les Syriens devaient d’abord faire une demande d’asile en Turquie. S’ils essayaient de faire une demande d’asile en Grèce, ils n’étaient pas examinés sur la situation dans leur pays d’origine, mais sur celle de la Turquie. Beaucoup d’entre eux ont été déboutés à cause de ça, explique Kleio Nikolopoulou. Sauf que depuis 2020, la Turquie n’accepte plus les réadmissions de Grèce. Depuis 2021, cela concerne également les Afghans, les Somaliens, les Pakistanais et les Bangladais.» Ces gens se retrouvent donc au beau milieu d’un sinistre jeu de ping-pong.
Les camps du désespoir
Lorsqu’ils sont déboutés ou en attente de leur jugement, les demandeurs d’asile se retrouvent dans des camps. Avec une somme minimale pourvue par l’Etat (et donc par l’UE) pour leur subsistance de 70 euros par mois pour un homme seul. Ces camps abritent parfois illégalement des réfugiés qui ont obtenu l’asile, car celui-ci ne rime pas avec intégration efficace. Loin s'en faut.
Fin 2021, le gouvernement grec inaugurait sa nouvelle génération de camps de réfugiés, à Samos. Mais si les migrants sont majoritairement hébergés sur les différentes îles grecques (largement démontré par Michael Wyler dans des reportages pour Bon pour la tête), Athènes en abrite également quelques-uns, en dehors de la ville. A l’image du camp d’Eleonas, situé dans une zone industrielle, à l’abri des regards.
Là-bas, les réfugiés peuvent aller et venir à leur guise, conférant un sentiment de liberté vue de l’extérieur. Mais le camp est barricadé et entouré de barbelés, ce qui rappelle une prison à ciel ouvert. Pour visiter le camp, constitué de baraquements de fortune et de conteneurs, il faut faire une demande officielle, souvent rejetée. Le camp d’Eleonas est voué à disparaître. Propriété du maire, celui-ci souhaite utiliser ses terres à meilleur escient.
Francine, Congolaise de 36 ans, est en Grèce depuis trois ans. Ses deux enfants y sont nés. Elle a été ballotée dans plusieurs camps, au rythme des refus de ses demandes d’asile. Comme ses compagnons d’infortune, qui se dénombrent par centaines, elle ignore ce qu’il adviendra de sa famille lorsqu’ils fermeront le camp.

Francine et ses enfants, nés en Grèce. © A.D
Triste record
Le 23 mai dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a issu un communiqué pour marquer le triste record des 100 millions de déplacés à travers le monde.
«Je pense que la situation est outrageante, témoigne Kleio Nikolopoulou. Je travaille dans ce domaine, en tant qu’avocate de réfugiés, depuis 2011. J’ai été confrontée à différentes problématiques. Mais je peux sincèrement dire que c’est la pire période que je n’ai jamais vue. Les problèmes sont répandus, commençant par l’accès au territoire pour les gens qui échappent à la persécution, jusqu’à l’accès à la procédure d’asile, ainsi que la politique d’intégration qui est pratiquement inexistante. Les problèmes sont partout et on a le sentiment de heurter un mur en permanence.»
La situation des réfugiés a-t-elle empiré depuis la guerre en Ukraine? «Je ne crois pas, soupire l’avocate. C’est plus ou moins la même. Mais elle est catastrophique depuis tellement longtemps qu’il serait difficile d’imaginer bien pire.»
ONG persécutées
Pour palier à l’action déficiente du gouvernement, la solidarité civile se met en place et de nombreuses associations sont créées pour tenter de venir en aide aux réfugiés. Mais, là aussi, les écueils sont légion. La fondatrice d’une ONG que nous avons interrogée – et qui tient à rester anonyme – explique comment le gouvernement essaie d’imposer un contrôle sur leurs activités en leur demandant de répondre à des critères toujours plus sévères pour être enregistrées. Comme de débourser 6'000 euros d’inscription auprès du ministère. « Si nous avions ce montant, nous l’utiliserions pour pourvoir de l’aide à nos affiliés, explique la fondatrice. C’est de l’intimidation!»
Selon cette dernière, l’Union européenne désapprouve ce bâillonnement des ONG, mais cela n’a aucun impact concret.
Lueur d’espoir?
«Ce que nous démontre la réponse à la crise ukrainienne, c’est que l’Europe peut le faire. Y compris lorsque le nombre de réfugiés est immense (plus de 6 millions d’Ukrainiens) et qu’il arrive soudainement, déclare l’UNHCR par le biais de Stella Nanou. L’Europe est parvenue à répondre de façon très efficace et solidaire, dans une approche centrée sur l’humain. Nous y sommes parvenus parce que nous avons agis de façon unie et organisée. C’est impressionnant, en particulier de la part de petits pays comme la Moldavie, qui a accueilli un million de réfugiés.»
Elle prévient cependant: «Nous devrions faire attention à ne pas prendre cette solidarité pour acquise. Pour qu’elle ne s’efface pas, le partage de responsabilité est important. Le pays refuge ne doit pas ressentir qu’il est laissé seul.
En 2015, la Grèce a été abandonnée. Les Grecs ont ouvert leur maison, leur cœur, se sont rendu sur les côtes pour apporter leur aide. Mais après quelques années, les habitants ont eu le sentiment d’être abandonnés. Laissés seuls face à ce fardeau. Ce qui s’est transformé – pas pour tout le monde – en hostilité face aux réfugiés. Et nous ne pouvons pas laisser ceci se reproduire.»
«Je ne pense pas qu’il serait si difficile de changer la situation, conclut Kleio. Il suffirait de suivre les procédures que nous sommes censés suivre en accord avec nos propres lois. Il suffirait de respecter les droits basics des demandeurs d’asile.»
C’est à Mary, Suissesse fondatrice de l’association Choosehumanity qui défend les réfugiés avec une détermination représentative de cette bouleversante solidarité, que nous laisserons le mot de la fin: «On les humilie en faisant totalement abstraction de l’humanité dont ils et elles ont besoin plus que tout. De reconnaissance. De respect aussi. Le peu de réaction de leur part en assistant à l’accueil de qualité réservé aux ressortissants ukrainiens en atteste. Aucune révolte. Ces personnes baissent la tête dans un automatisme naturel induit par tout ce qu’elles ont déjà enduré.»



L'intérieur d'un container. © A.D

Distribution de nourriture au camp. © A.D













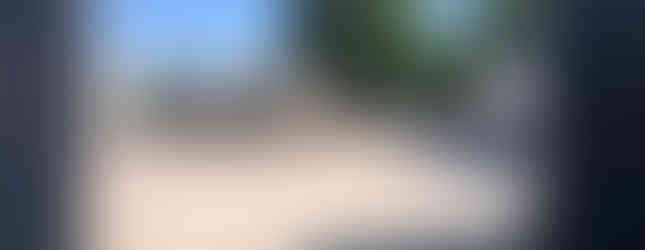










댓글