Pollution sonore: grand silence autour du bruit
- Julien Monchanin, Toulouse

- 17 août 2025
- 11 min de lecture
Dernière mise à jour : 24 août 2025
Dans les débats sur l’environnement, les nuisances sonores sont bien souvent reléguées au second plan, sinon ignorées. Outre son coût colossal et sa nocivité sur le plan sanitaire, le bruit révèle un inquiétant déclin du civisme et de l’intellect dans nos sociétés. Petit voyage dans un enfer invisible.

Conversations téléphoniques dans les transports en commun, travaux domestiques, aboiements de chiens, cris et musique à fond jusqu’à 4 heures du matin: qui, aujourd’hui, n’a pas eu à subir les nuisances sonores engendrées par un voisinage peu respectueux? Au-delà des traditionnels bruits de circulation et du fond sonore extérieur, les bruits dits «de comportement», produits par l’homme ou son animal, semblent causer de plus en plus d’irritations. Les victimes pointent souvent du doigt le manque de civisme et le sans-gêne de voisins immédiats «qui se croient tout permis». Et les responsables, bien sûr, crient à l’intolérance. Naissent ainsi des conflits assez typiques de nos sociétés individualistes où chacun, tourné vers son propre bien-être, fait fi de l’autre et des lois.
Il est aujourd’hui communément affirmé que nous vivons dans un monde de plus en plus bruyant. C’est du moins ce que nous ressentons au quotidien, mais la chose va-t-elle vraiment de soi? «Il n’y a pas nécessairement plus de bruit qu’avant. Il aurait fallu faire des études prospectives dans le passé pour le vérifier, mais cela n’a jamais été fait. Le territoire français était aussi très bruyant dans les années 50, soutient Justine Monnereau, responsable du pôle communication et ressources du Centre d’information sur le bruit (CidB). Nous existons depuis 1978 et le nombre d’appels que nous recevons n’a ni augmenté, ni diminué. En revanche, on peut parler de nouvelles sources de bruit». Parmi ces «nouveaux bruits», on peut citer les pompes à chaleur, les climatiseurs ou encore les éoliennes, qui occasionnent un nombre croissant de plaintes.
Autant de bruit, mais plus de bruits?
Même son de cloche du côté de l’Association AntiBruit de Voisinage (AAbV). Sa présidente Anne Lahaye constate que le nombre d’adhérents de l’association, tous victimes de leur environnement sonore, n’évolue pas forcément. Ils sont entre 8000 et 10'000, particuliers ou collectifs de riverains. «Ce qui change, ce sont surtout les types de bruit», remarque elle aussi la responsable. L’AAbV mène sur le sujet une enquête permanente en ligne plutôt instructive. Près de 2500 personnes y ont répondu. Mais le diagnostic est ici un peu différent. «Il y a 25 ans, les cris d’animaux ressortaient en tête des bruits perçus», explique Anne Lahaye. Désormais, ce sont les bruits d’immeubles ou de maisons mitoyennes (près de 35%), devant les pompes à chaleur et climatiseurs (24%) et les bars et restaurants (15%). Les cris d’animaux n’arrivent plus qu’en 4ᵉ position (9,5%).
Qu’on l’évalue à son volume global, à sa permanence, à sa géographie ou à la diversité de ses sources, il semble tout de même difficile de nier que le problème s’est amplifié. «Tout le monde est concerné, mais peu osent se plaindre, parfois par peur d’aller en justice ou de représailles. Nous ne pouvons évaluer l’ampleur du phénomène qu’à travers ceux qui craquent et se manifestent», souligne Anne Lahaye, qui indique en outre que «les agents des forces de l’ordre refusent encore assez souvent de prendre mains courantes et plaintes pour des bruits de voisinage». Ainsi, la majeure partie des victimes du bruit échappe sans doute aux radars statistiques et passent inaperçues, bien que nos sources policières évoquent une augmentation notable des plaintes pour nuisances sonores. Bref, quelques indices suggèrent tout de même une dégradation de la situation.
Lorsque l’on se penche sur l’origine du bruit, la plupart des études de perception ou déclaratives le montrent: ce sont bien ces «bruits de voisinage» qui gênent avant tout les Français. Une enquête du CidB, réalisée en 2021 auprès de 164 communes sur la base des nuisances sonores qui leur ont été signalées, le prouve clairement. Les «bruits de comportement» arrivent en tête avec un score de 32%, devant les bruits de transport routier, ferroviaire ou aérien (21%), les «sports et loisirs» (13%) et les chantiers (11%). Il faut noter que ce basculement paraît relativement récent, car une précédente enquête, réalisée en 2010 par TNS-Sofres, plaçait encore le bruit des transports en tête des nuisances sonores subies par les Français (à 54%, contre 21% pour les bruits de comportements). Là-dessus, les théories divergent. Certaines font du Covid un facteur aggravant, alors que les citoyens ont longtemps été assignés à résidence et contraints de supporter leurs voisins en permanence.
Suisse: les deux-roues ciblés
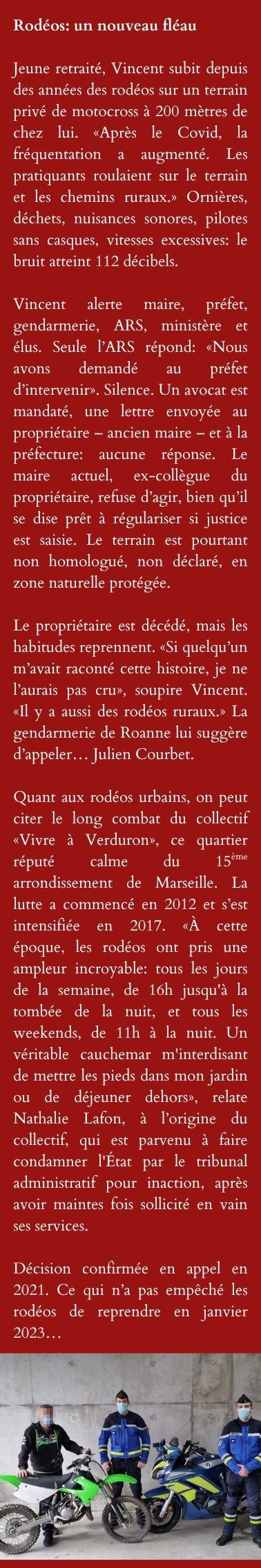
D’autres études menées avant la pandémie laissaient cependant déjà supposer cette évolution. En 2017, l’Insee avait publié une enquête sur «les conditions de logement en France», fondée sur des données de 2013 et incluant une section «Confort, qualité et défauts du logement» dans laquelle la question du bruit était abordée. À l’époque, 47,9% des ménages en habitat collectif se déclaraient gênés par des bruits de voisinage, contre 43,2% par des bruits de circulation. Puis, en 2018, une enquête réalisée par Ipsos dans le cadre de la fête des voisins en remettait une couche. Elle nous apprenait que 30% des Français déclaraient avoir déjà eu des tensions avec leurs voisins à cause du bruit, chiffre atteignant 42% chez les habitants d'appartements. Dans 69% des cas de conflits de voisinage, le bruit apparaissait comme le principal motif. Le podium des bruits les plus gênants pour les habitants d’appartements? les fêtes et soirées (32%), les éclats de voix (29%) et la circulation (24%).
Toutes ces données sont en partie tempérées par celles d’une autre enquête publiée en 2021 par l’Ademe, fondée non sur le ressenti de citoyens, mais sur des données scientifiques, économiques et épidémiologiques. Elle évaluait le «coût social du bruit» à plus de 147 milliards d’euros. Ce coût social regroupe les dépenses de santé, les pertes de productivité, la dévalorisation immobilière, ainsi que la dégradation du bien-être et de la qualité de vie, convertis en valeurs économiques. Or 66,5% de ce coût proviendrait des seuls transports routier (54,8%), ferroviaire (7,6%) et aérien (4,1%). Ne viendraient qu’ensuite les bruits de voisinage (17,9%). Mais si la méthodologie de l’Ademe semble robuste au chapitre des nuisances de masse, elle sous-estime probablement le coût psychologique, économique et social des bruits de voisinage, par essence plus difficile à estimer dans toute son étendue. Les effets du stress, de la tension relationnelle, du sentiment d’impuissance des victimes ou de la simple perte de concentration sont, en effet, moins objectivables.
En termes de ressenti, la situation diffère un peu en Suisse, où les associations pointent encore du doigt les bruits des voitures, trains, avions… et des deux-roues, qui concentrent ces derniers temps toute l’attention, plutôt que les troubles de voisinage. D’après un «état de l’exposition au bruit en Suisse» publié en 2015 par l’Office fédéral de l’environnement, pas moins d’un million d’Helvètes seraient gênés par des nuisances sonores, en particulier en milieu urbain. «Beaucoup de personnes se disent dérangées par les bruits de circulation. Nous recevons beaucoup plus d’appels concernant les motos», glisse Susan Glättli, directrice de la Ligue suisse contre le bruit, qui confirme que les Suisses sont globalement respectueux de leurs voisins, malgré un nombre croissant de réclamations touchant… aux pompes à chaleur. Grâce à leur traditionnel civisme, les Suisses échapperaient donc encore à la tendance française.
Bruit partout, silence nulle part
Après l’expérimentation-pilote de radar antibruit à Genève l’an dernier, le Conseil fédéral a durci en début d’année le niveau des amendes pour les amateurs de coups d’accélérateur intempestifs. Ces amendes peuvent désormais grimper jusqu’à 10'000 francs suisses. D’autres mesures ont été prises, comme des amendes de 60 à 80 francs pour ceux qui laissent inutilement tourner leurs moteurs. Pour des solutions plus «pacifiques», Susan Glättli préconise des mesures simples comme une meilleure gestion de l’urbanisme, des revêtements insonorisés ou une réduction des vitesses. Dans un esprit de concorde, on notera que Motosuisse et d’autres organisations ont lancé en 2022 une campagne «Respect plutôt que bruit» visant à promouvoir un meilleur comportement parmi les motocyclistes.
Retour en France, où le cas d’Éric*, 45 ans, illustre bien le nouvel éventail des bruits qui empoisonnent la vie des citoyens. Il a acquis dans les années 2000 un studio dans un quartier calme de la Capitale. «Au début tout allait bien. Une galerie d’art occupait le rez-de-chaussée de l’immeuble. Côté cour, on entendait bien les fêtes occasionnelles d’une colocation d’étudiants, mais rien d’insupportable», raconte-t-il. Et puis ladite galerie s’est vendue et a été remplacée par un club privé, avec au menu cris de fumeurs dans la rue et musique à fond un soir sur deux: «Les propriétaires n’ont jamais été inquiétés. Un soir, je suis descendu me plaindre et ils m’ont même menacé avec un fusil». Ou quand le bruit va de pair avec les incivilités.
Au problème d’Éric se sont en outre greffées, côté rue, les livraisons nocturnes au magasin de vins situé plus haut et l’arrivée de familles nombreuses dans des bâtiments réaménagés en HLM. «Les hurlements et la musique à fond sont devenus quotidiens», relate Éric, qui vendra son studio pour emménager chez sa compagne, dans un quartier plus populaire, où il subira «une foule de gens qui stagnaient dans la rue devant un snack et parlaient fort à toute heure» et, pire, «la famille du gardien de l’immeuble, qui vivait au rez-de-chaussée et a réussi à acheter l’appartement voisin. Les cinq occupants faisaient des allées et venues à l’étage et frappaient peut-être 50 fois par jour à la porte de leur appartement, car ils n’avaient qu’une clé. Ils ont aussi fait des travaux et supprimé toute l’isolation pour gagner de l’espace. Sourd, le propriétaire mettait le son de sa télé à un volume ahurissant, même pendant la nuit».
Vers un déclin du civisme?
Toutes les démarches d’Éric se sont avérées vaines. Habitué à la vie urbaine, il n’a pourtant jamais été gêné par les bruits de circulation. Sa compagne vendra à son tour et le couple voyagera à travers le monde, passant d’une location à l’autre, à la recherche d’un endroit calme où s’installer pour de bon. Quête longue et difficile: 8 ans et 44 pays plus tard, le verdict est sans appel: «Partout, nous avons été dérangés par des bruits de comportement de type télévision, aboiements de chiens laissés sur les balcons, musique à fond, cris et autres. Même au fin fond du Québec, en forêt, avec des maisons distantes les unes des autres, nous avons enduré trois jours de travaux infernaux». Éric se souvient aussi du Vietnam, «où le concert de klaxons était franchement pénible. C’est drôle, mais la France et le Japon sont finalement les pays les plus calmes qu’on ait visités», conclut-il. Éric vit désormais en appartement sur une île touristique: «Il y a une agence de location de voitures dont le nettoyage occasionne du bruit, des boîtes de nuit qui créent un lointain fond sonore, mais cela reste vivable».
Dans ce monde où nul n’échappe plus au bruit, se combattent ainsi les opinions de ceux qui le subissent et de ceux qui le produisent ou s’en accommodent. Si les deux partis sont souvent renvoyés dos à dos, il existe pourtant en France un cadre légal qui permet de trancher. Or force est de constater, comme dans le cas d’Éric, que les fauteurs de troubles sont la plupart du temps hors la loi au regard des critères considérés que sont l’intensité du bruit, sa durée, sa répétition et le contexte local, et ce quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. L’irrespect de lois censées garantir les conditions d’un vivre-ensemble harmonieux fait de ce point de vue apparaître le bruit comme une conséquence générale d’un déclin du civisme, de l’éducation et du savoir-vivre.
Des conséquences sanitaires
Pour faire entendre leur voix dans le tumulte, les victimes n’ont d’autre choix que de suivre les étapes d’une procédure qui s’apparente à un marathon, de la démarche à l’amiable jusqu’au procès en passant par la médiation. Loin d’être à la hauteur de l’enjeu, cette procédure oblige la plupart du temps le citoyen impuissant à s’engager dans un combat de plusieurs années, sans garantie de succès (voir notre encadré sur les rodéos).
Quoique le problème soit souvent minimisé, ses conséquences sanitaires et sociales sont pourtant très étudiées et avérées. Troubles du sommeil, effets cardiovasculaires, stress chronique, santé mentale, développements prénatal et cognitif de l’enfant, effets sociaux indirects comme l’isolement ou la réduction de l’activité physique: les répercussions sont nombreuses. Et, bien entendu, les atteintes auditives en sont la conséquence la plus directe, incluant les troubles de l’audition (un Français sur 4, selon l’Inserm) ou les acouphènes: 15 millions de Français en souffriraient, d’après les Journées Nationales de l’Audition. JNA qui avancent qu’un Français sur deux serait exposé au bruit et sujet à des pertes d’audition. Tout cela sans compter d’autres types de conséquences, comme par exemple sur la biodiversité ou les inégalités sociales, confirmées par divers travaux.
La situation peut même relever du calvaire pour certaines populations sensibles. Touché par une hyperacousie que renforcent des troubles autistiques, Stéphane, 49 ans, est musicien et vit en appartement à Rennes. «Tous les bruits trop forts m'insupportent, en particulier de motos, de travaux publics (je change de trottoir ou évite la rue) et d’alarmes de voiture ou de locaux. J'ai déjà eu trois mois d'acouphènes à cause d'une simple alarme», explique-t-il. «La plupart des alarmes sont nocives pour l'audition et devraient être interdites. J’avais aussi un voisin qui écoutait de la musique toute la nuit. Je ne supporte pas non plus les bruits de moteur. Je mets un casque antibruit pour passer l'aspirateur. Je vais très rarement au cinéma alors que j'adore ça, parce que depuis quelques années le son augmente sans cesse». Concernant les conséquences sur sa santé, il évoque les fatigues nerveuse et auditive, le stress, la colère.
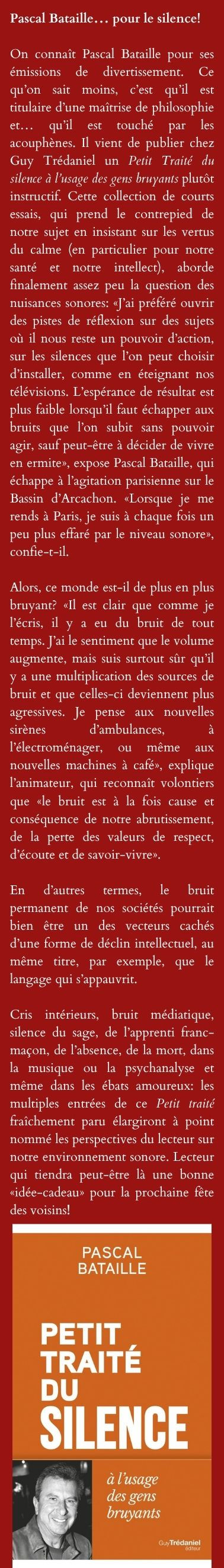
Quand le bruit nous abrutit
Pour lui, aucun doute, la situation empire: «Il y a de plus en plus de bruit et de moins en moins de personnes qui y font attention. Le volume augmente dans les cinémas, stades, concerts, soirées. La plupart des gens que je croise sont tellement inconscients de ce qu'ils ressentent réellement, que cela ne les gêne pas, et certains adorent même le bruit», se désole-t-il. Non sans lucidité: «Effectivement, les troubles d'hyperacousie et les difficultés liées au bruit sont amplifiées pour les gens comme moi, souvent hypersensibles. Les bruits peuvent déclencher des crises de colère ou de rage chez les autistes. On devrait communiquer sur les difficultés liées au bruit pour ce type de personnes. J'emmène toujours mon casque antibruit quand je pars en vacances. Cela dit, il devrait être normal d'être sensible au bruit. Être insensible au bruit, voilà qui est anormal et montre un endormissement total des sens humains, une soumission sociale à ce qui est conformément admis sans réfléchir».
C’est là l’une des causes, mais aussi des conséquences les moins commentées du bruit: il participe du déclin de l’intellect en s’attaquant à notre concentration et en altérant nos facultés cognitives, en particulier chez l’enfant. Une étude publiée par l’Agence européenne de l’environnement (AEE), il y a quelques mois, avance, par exemple, que «plus d’un demi-million d’enfants en Europe souffrent de troubles de la lecture en raison du bruit ambiant provenant des transports routiers, ferroviaires et aériens». Une enquête d’Opinionway, réalisée en 2021 dans le cadre de la «Semaine du son», révélait déjà l’impact du bruit sur la concentration des élèves en milieu scolaire. Les travaux plus généraux de l’OMS et de l’AEE évoquent également les effets négatifs sur la cognition, la concentration et les capacités de raisonnement chez l’adulte (voir liens en fin d’article).
Au chapitre des solutions, Stéphane plaide pour une baisse de volume des alarmes et du son des concerts, cinémas et soirées, avec des seuils d’interdiction, ainsi que pour une «éducation au silence, à l'écoute, en milieu scolaire» et une «sensibilisation au bruit et aux nuisances sonores dans les médias, avec des amendes pour ceux qui ne respectent pas les seuils imposés». À l’arrivée, il dit ressentir «beaucoup de colère sur ce sujet, car personne ne s'en préoccupe sérieusement». Le CidB, lui, milite pour l’instauration d’espaces de calme et de zones de repos labellisées, avec l’appui de l’UE. Mais la lutte contre le bruit passera avant tout par une réelle prise de conscience…
Grand silence médiatique
Malheureusement, Anne Lahaye confirme que subsiste un «silence médiatique sur le fond du sujet. Beaucoup d’articles sont publiés en lien avec le bruit, mais souvent légers, sur des cas marginaux et caricaturaux». On peut, par exemple, citer tous ces papiers relatant des procès intentés à cause de bruits ruraux de type cris d’animaux ou cloches d’église, prenant souvent fait et cause pour les gêneurs, «tandis que les procès gagnés par les victimes passent inaperçus». Le politique, naturellement, suit l’opinion: des lois sont récemment passées en France pour protéger le «patrimoine sensoriel» des campagnes (29 janvier 2021) et instaurer un droit d’antériorité en matière de troubles du voisinage (15 avril 2024). Mais cette dernière loi «ne dit pas qu’avec les preuves adéquates de l’anormalité des pollutions sonores, les victimes ne peuvent pas s’en défendre», précise Anne Lahaye.
Pour tous nos interlocuteurs, ce silence médiatique s’explique assez simplement: le bruit ne se voit pas, ne se touche pas et tant qu’il n’y a pas de plaintes officielles, il n’y a pas de bruit, du moins pour les administrations. «Depuis le Covid, il y a cependant une prise de conscience. Et puis c’était aussi le cas pour la pollution atmosphérique il y a 50 ans. On espère que le traitement de la pollution sonore suivra le même chemin. À travers nos actions, nous essayons d’ailleurs de rattacher le bruit aux problématiques environnementales», conclut Justine Monnereau. Qui sait? La lutte contre la pollution sonore finira peut-être par faire du bruit…
*Prénom modifié
Pour aller plus loin:
Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018) - Organisation mondiale de la santé
Environmental Noise in Europe (2020) - Agence européenne de l’environnement
Rapport « Bruit et biodiversité » (2020) – Bruitparif








Merci pour cet article et vive le silence!
Un regret : vous avez oublié la Belgique, où crèche, aussi, la bureaucratie européenne. Tant qu'à annexer la France, autant annexer la francophonie.
Une remarque pour Bataille : on n'éteint pas la télévision mais son téléviseur.
Éteindre la télévision pourrait par contre être salutaire à la civilisation, en supprimant une source de formatage et d'addiction à l'image au détriment du verbe.
Si seulement on pouvait supprimer la musique quand les acteurs parlent au cinéma ou quand des commentateurs donnent des explications dans les documentaires et baisser l'intensité des fonds musicaux à la télévision!
Personnellement j’attends avec grande impatience l’interdiction de « téléphone » dans les transports publiques!
Comme avec la fumée ça prendra encore quelques années, mais VIVEMENT!!!