On a épluché la couverture médiatique de la période Covid
- Amèle Debey

- 13 avr. 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 21 avr. 2025
Grâce à la base de données SMD, qui regroupe les archives des titres de presse suisses, nous avons épluché les 258'265 résultats en français de la période Covid. Une plongée dans notre paysage médiatique, souvent fait de dépêches d’agence, de billets d’opinion grimés en information et de poursuite d'un narratif par le biais du tri des nouvelles. Retour vers le futur?

Nichée au milieu de l’Europe, la Suisse est un poste d’observation stratégique. Par la diversité de ses langues nationales et de ses influences culturelles, elle offre un miroir fascinant de la France, de l’Allemagne et de l’Italie à la fois. Durant la crise du Covid, ce miroir a révélé bien des fractures. Et un malaise médiatique profond.
Au début de l’année 2020, la couverture médiatique est encore teintée de curiosité. Les premiers cas sont évoqués avec prudence, la menace relativisée.
(Cliquez sur les images des diaporamas pour les agrandir)
Puis la mécanique s’emballe. Chaque jour apporte son lot de statistiques, de cas détectés par canton, de conférences de presse en direct. Le Diamond Princess illustre ce qui devient un feuilleton anxiogène. On commence à parler de chien infecté à Hong Kong. Rien n’est trop grotesque pour faire un titre. La machine est lancée.

📈 Plus de 73'715 articles publiés sur le Covid en 2020. Un matraquage sans précédent. Et surtout, un basculement: les célébrités testées positives deviennent des «informations». Le secret médical? Évaporé.

Rapidement, les choses s'accélèrent et on commence à trier les prétendues fausses nouvelles, sans prendre les précautions nécessaires. On sait aujourd'hui à quel prix.
De l’inquiétude à la croisade
En 2021 (79'940 articles), alors que l’UE publie ses contrats avec les pharmas — lourdement caviardés — la promesse vaccinale devient le nouveau credo. Ceux qui doutent sont d’abord considérés comme prudents. Mais la presse change rapidement de cap. Le vaccin devient la condition sine qua non du retour à la normale. Et malheur à celui qui pose des questions. Et pour cause:



Le ton se durcit. Les résistants sont pointés du doigt. Les «antivax» deviennent les boucs émissaires de la crise, dans un climat alimenté par les éditos vengeurs et les tribunes moralisatrices. La nuance disparaît, le doute devient suspect. Ceux qui osent l'exprimer deviennent égoïstes et criminels.
Peu à peu, la frontière entre information et opinion se délite. La star du tennis Novak Djokovic est ciblée pour sa décision de ne pas se faire vacciner:




Sans autres considérations déontologiques, les journalistes se joignent à la pression sociale contre ceux qui refusent de se faire vacciner. À l’image de Pierre Ruetschi, ancien président du Club suisse de la presse et ancien rédacteur en chef de La Tribune de Genève dans cette chronique publiée par le journal genevois:

«Il est temps de dire à la minorité antivaccin hurlante […] que cette liberté-là est non seulement égoïste mais autodestructrice»
On ne débat plus. On accuse. Et quand ce ne sont pas les antivax, ce sont… les antisémites. Plusieurs titres vont jusqu’à faire le lien, sans preuves tangibles, entre critique des mesures sanitaires et montée de la haine. Le tout, souvent, en admettant eux-mêmes qu’ils n’ont aucune donnée chiffrée à offrir.
Données manquantes également concernant les conséquences de la maladie autant que de la vaccination sur les femmes enceintes. Pourtant, en 2022, on peut lire: «Pour les femmes enceintes qui ont peur du vaccin contre le Covid-19, il va falloir faire un choix: oser la vaccination ou prendre le risque de perdre leur bébé si elles sont contaminées par le virus en cours de grossesse.»

L’éthique à géométrie variable
Le rôle des médias est-il d’informer ou de guider les comportements? À lire certains articles, on comprend que l’objectif n’était plus de documenter, mais d’accompagner la politique sanitaire en minimisant les doutes. Le mot d’ordre? Ne pas détourner de la vaccination.

L’angle, le choix du vocabulaire, la sélection des sources: tout contribue à créer un clivage entre bons et mauvais citoyens, alimentant une division dont la presse, pourtant si prompte à dénoncer les fausses informations ailleurs, porte ici une part de responsabilité.
Un cas d’école suisse
En Suisse, où coexistent plusieurs sensibilités linguistiques et culturelles, le constat est d’autant plus parlant. Ce petit pays est devenu le révélateur d’un mal plus vaste: l’uniformisation des récits, la peur du débat, la confusion entre prudence sanitaire et panique morale.


Aujourd'hui, on sait que les «cas» ne voulaient rien dire, pas plus que les morts étiquetés covid, puisque les tests systématiques par le biais d'un outil déficient comme la PCR brouillait les lignes. Comme nous l'a rappelé la scientifique Valérie d'Acremont dans notre bilan sur l'état du système de santé post-covid.
Mais ces questions-là, ces remises en contexte nécessaires étaient absentes du récit médiatique.
Et c’est peut-être dans les mots d’Alexis Favre, producteur de débats sur le service public, que réside le meilleur résumé de cette dérive. Dans une interview donnée à L’Impertinent, il admet sans détours:

Un devoir d’autocritique
Plus de cinq ans après le début de la crise, l’heure devrait être à l’introspection pour les médias. Pas pour raviver de vieilles querelles, mais pour poser une question essentielle:
À quoi sert encore un journal, s’il ne remet plus rien en question?








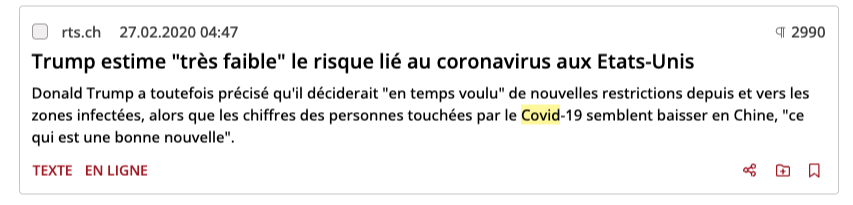
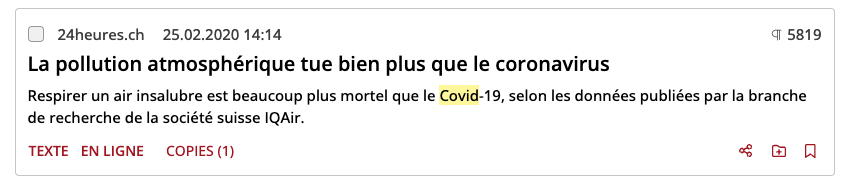
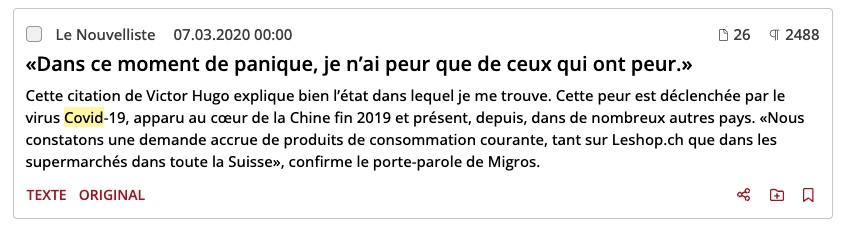












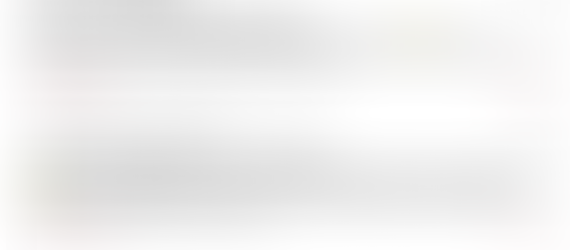










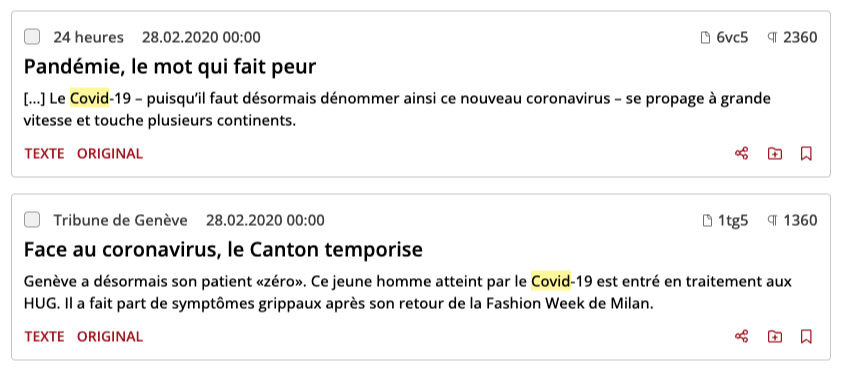





































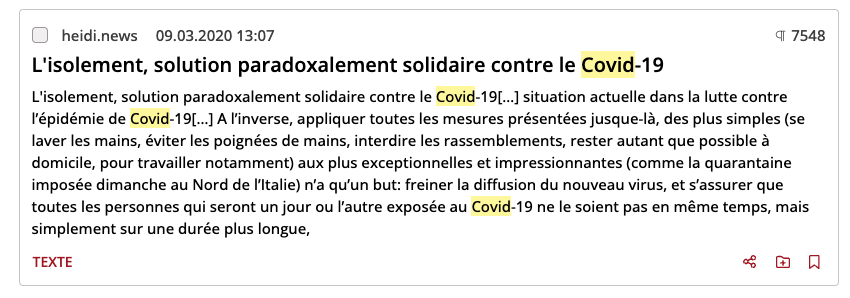

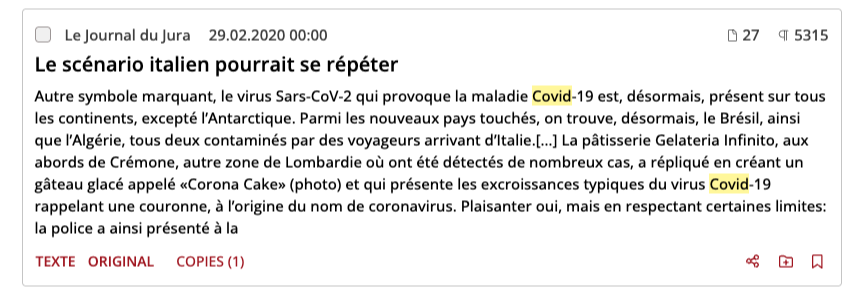

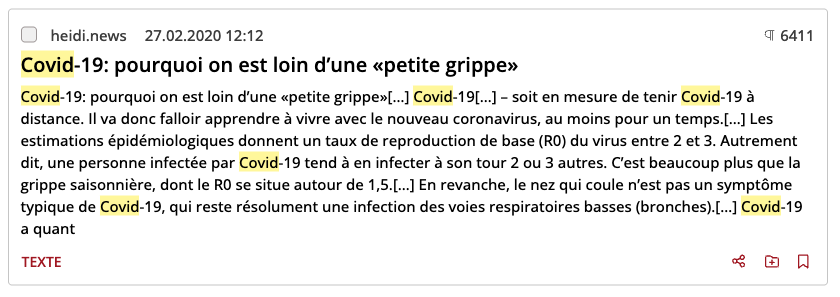




















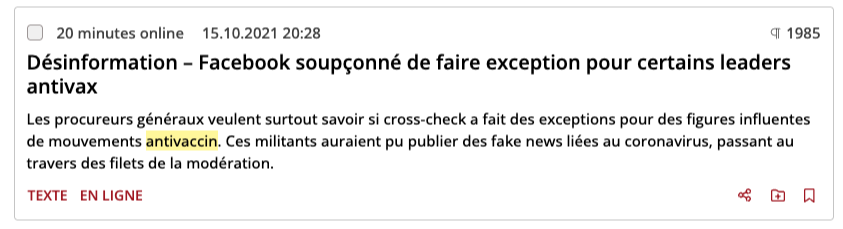







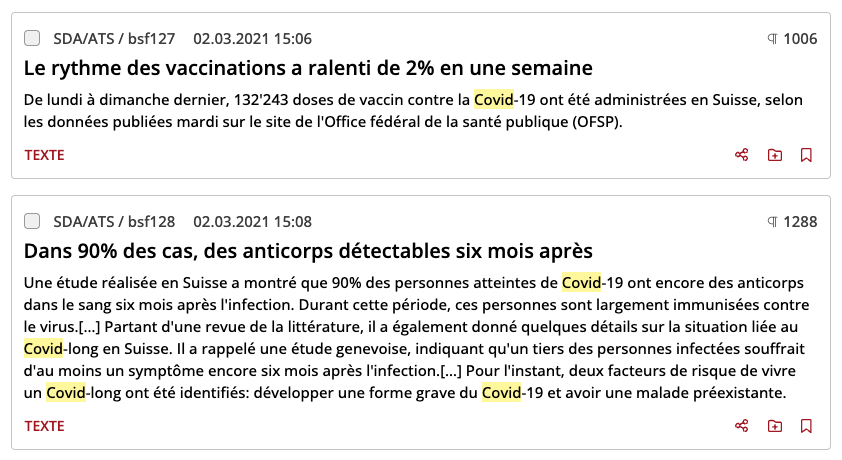











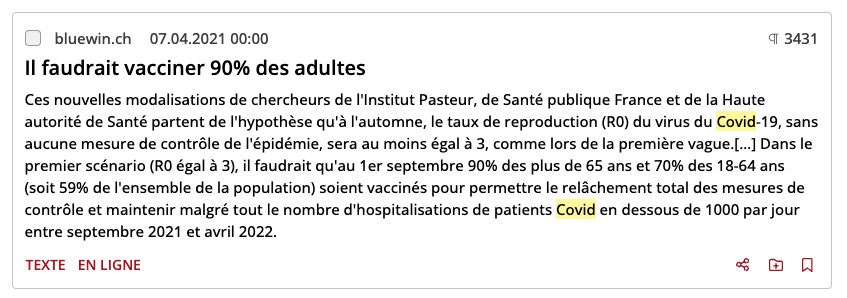


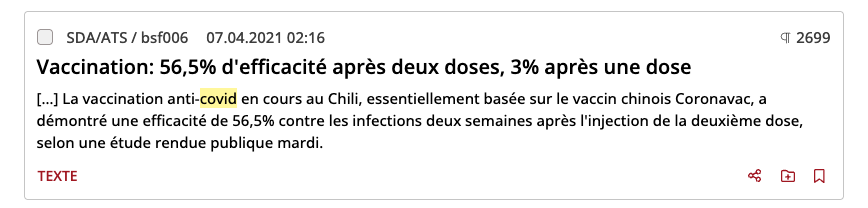


















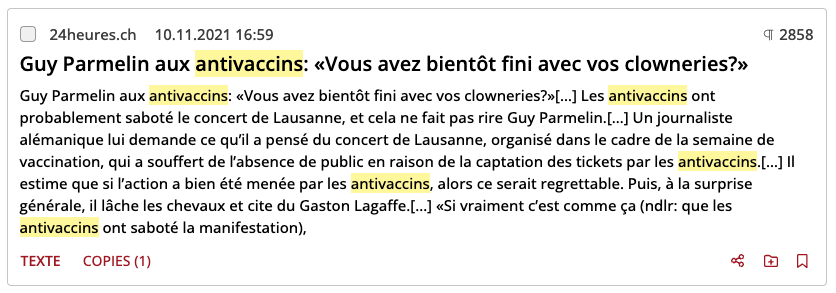


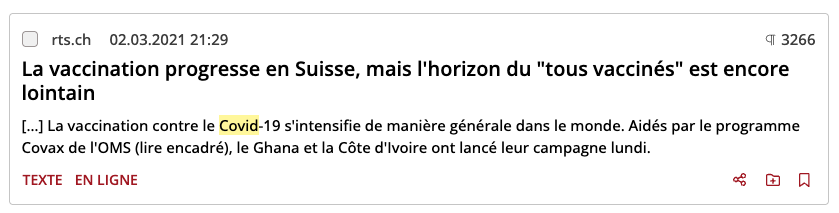






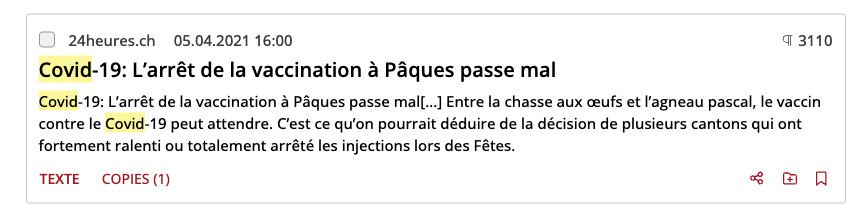






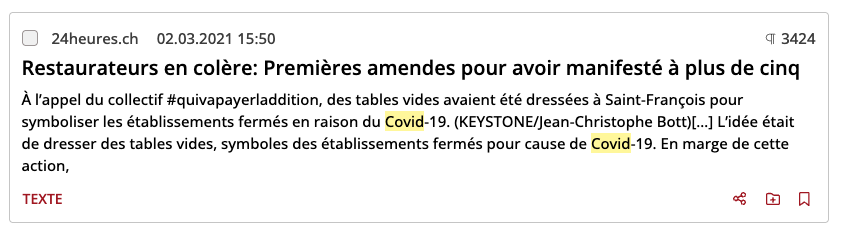

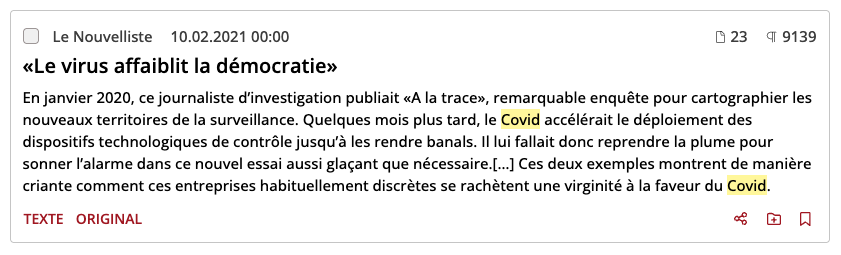

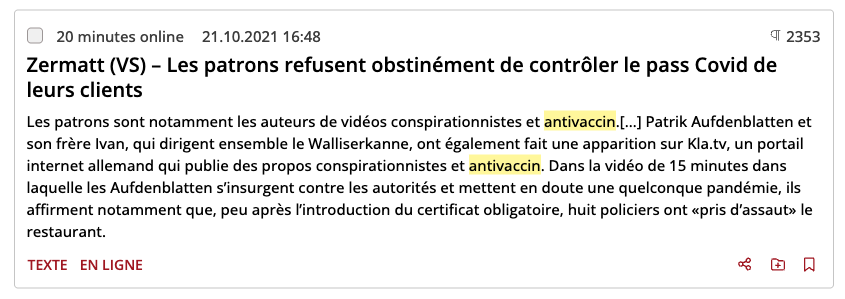


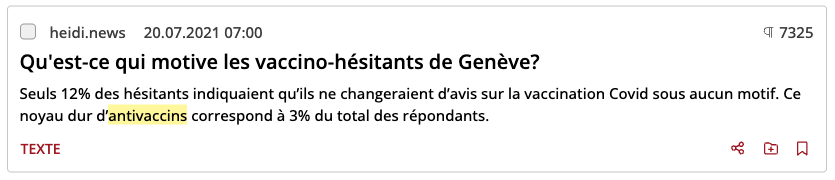
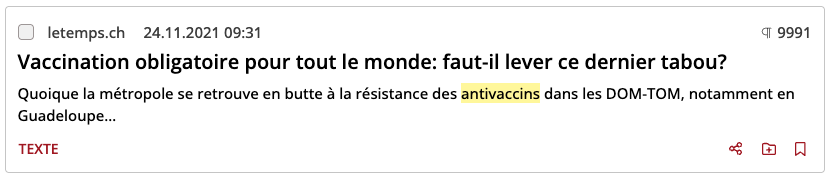

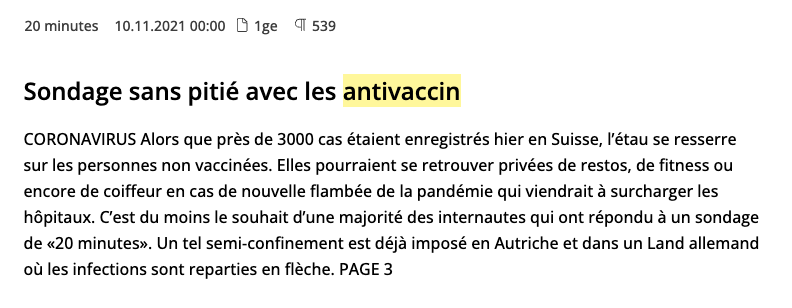
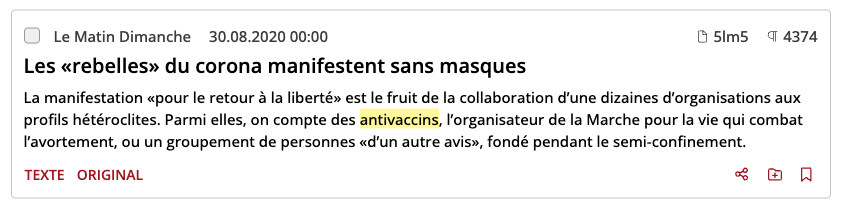
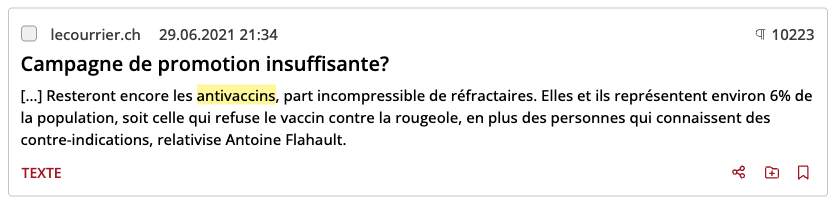



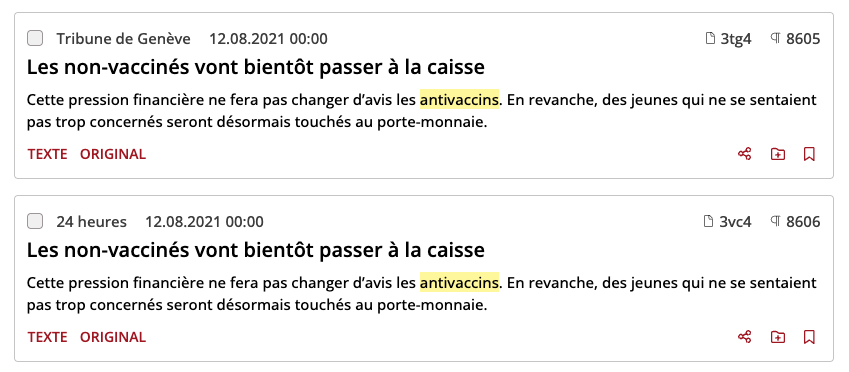
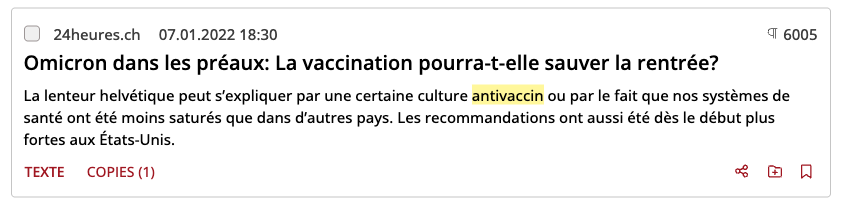

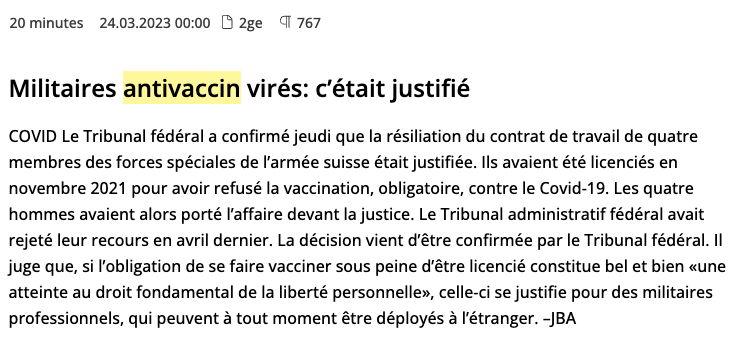
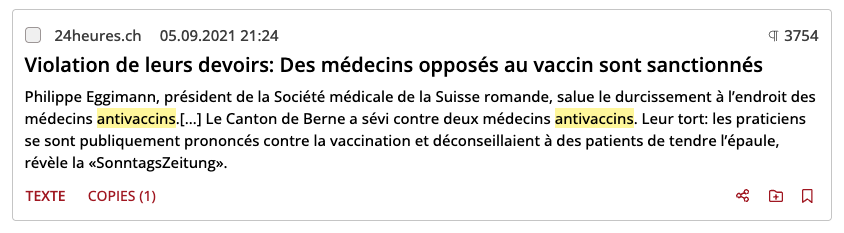

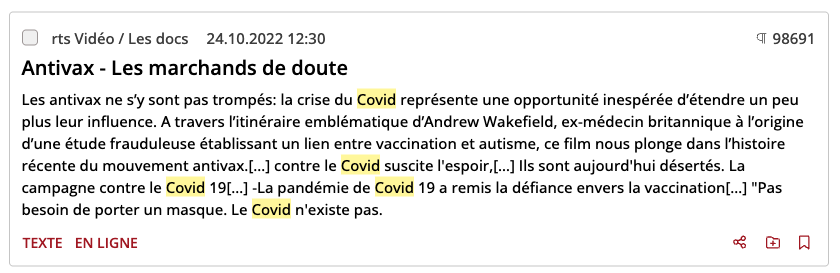
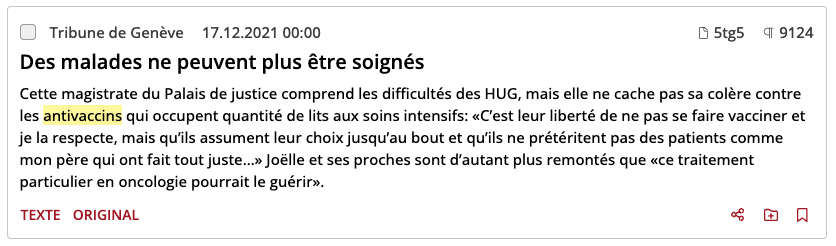

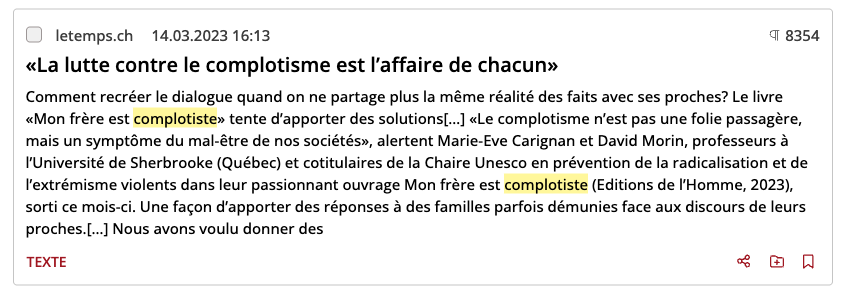

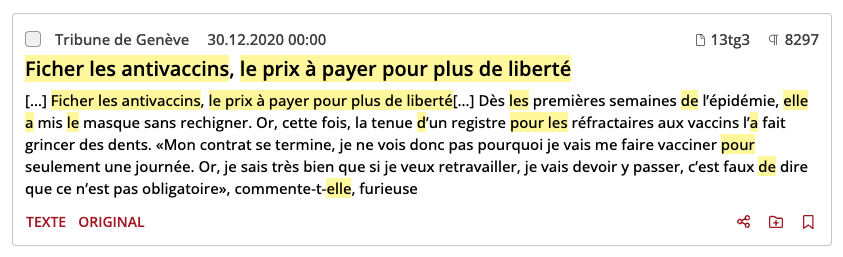
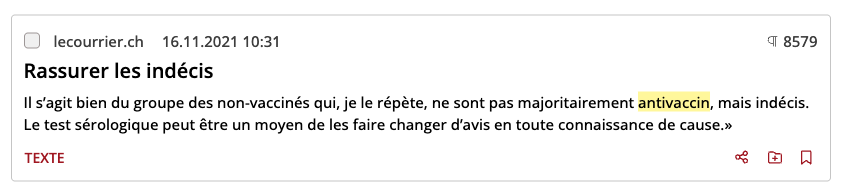

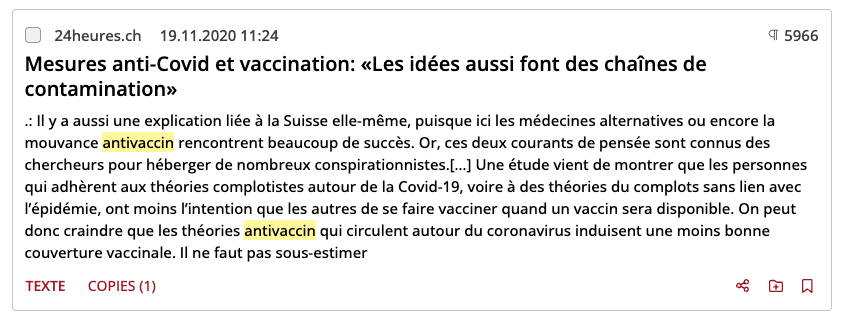

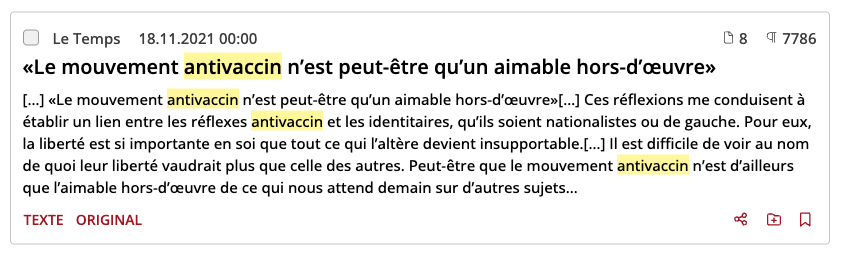
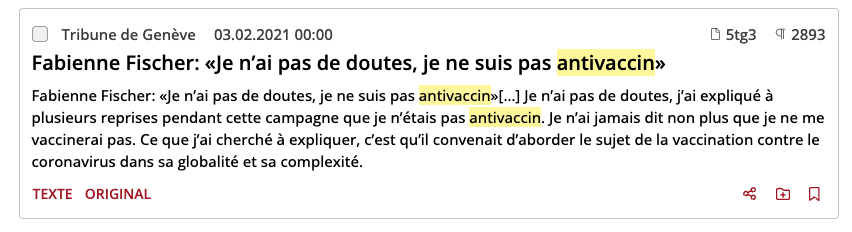
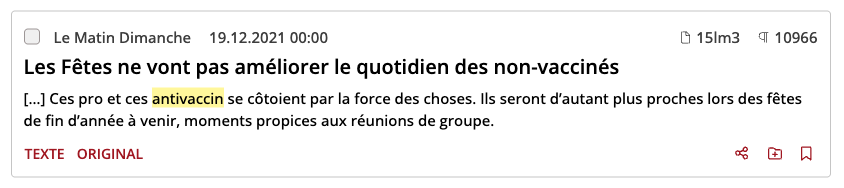
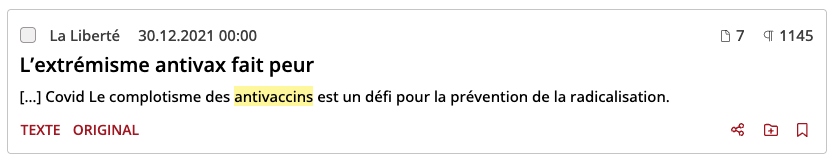

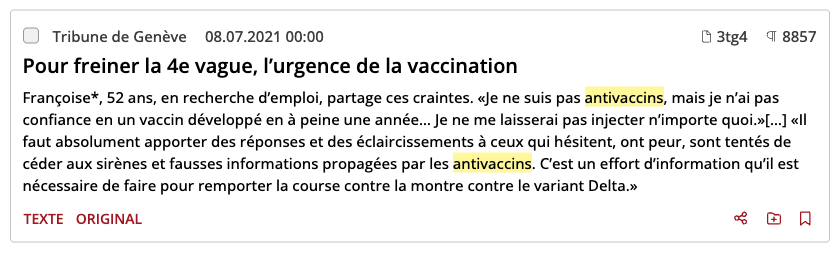

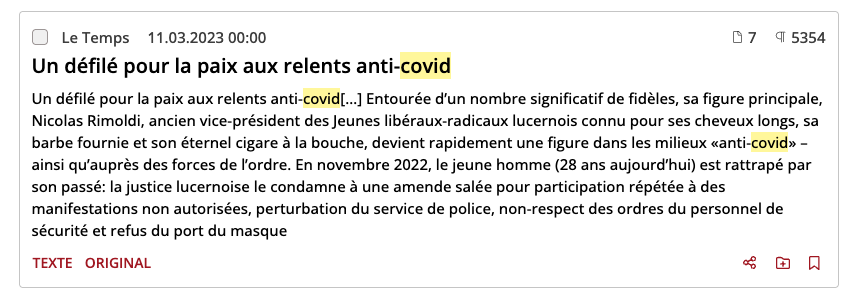

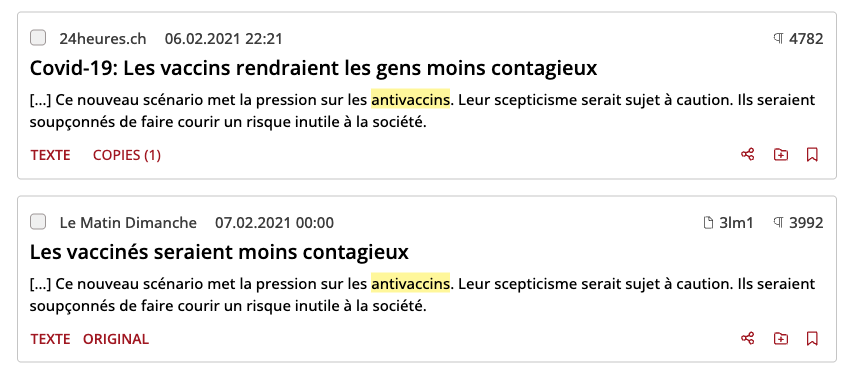

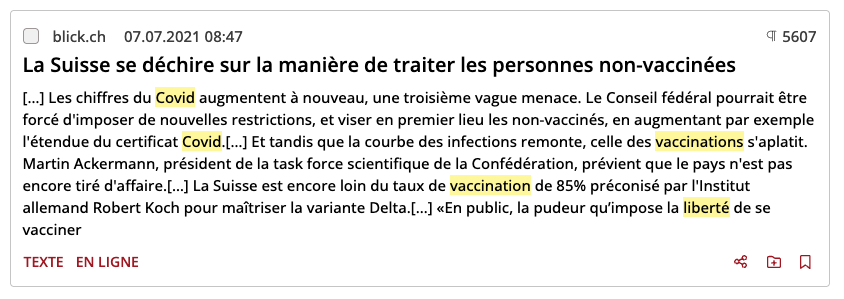



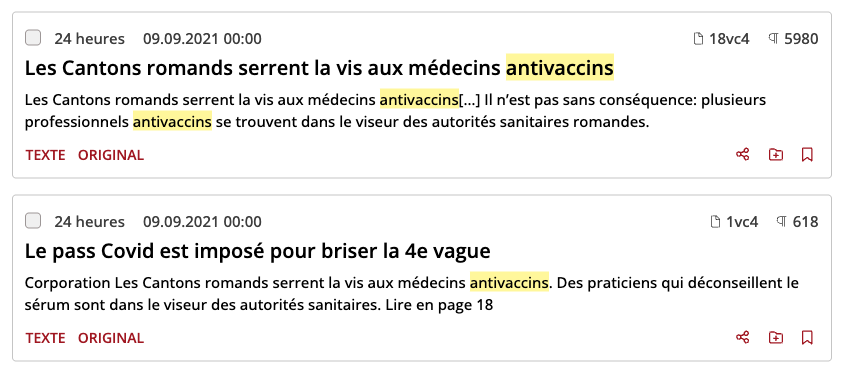



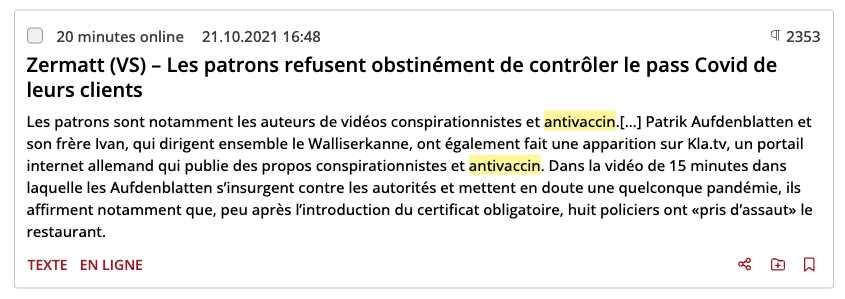

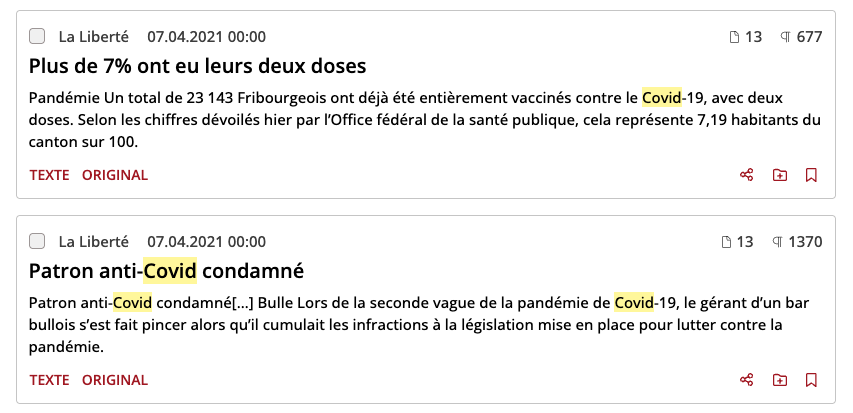

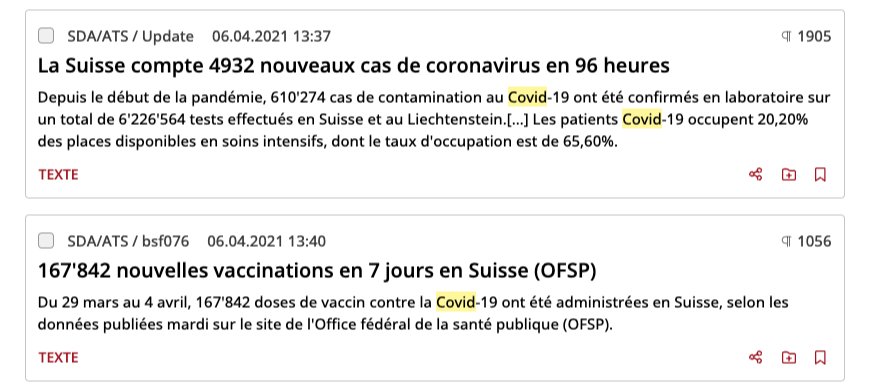





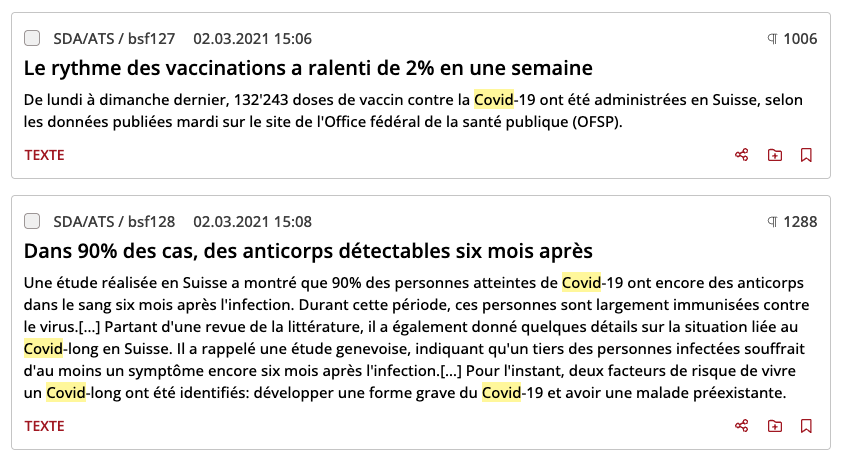







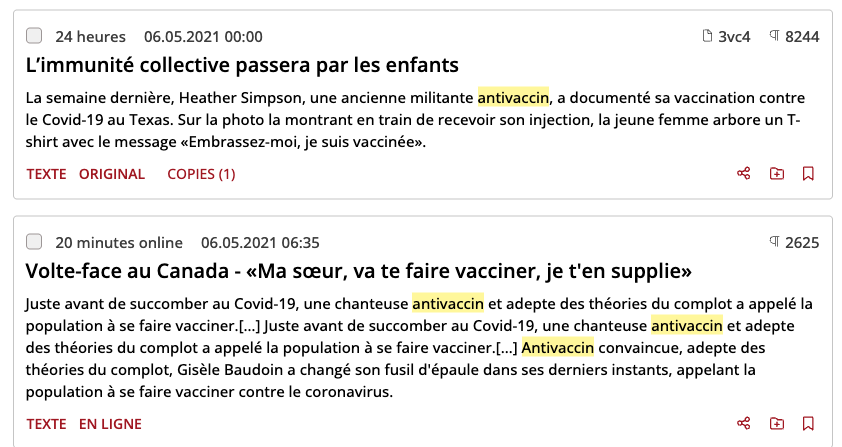




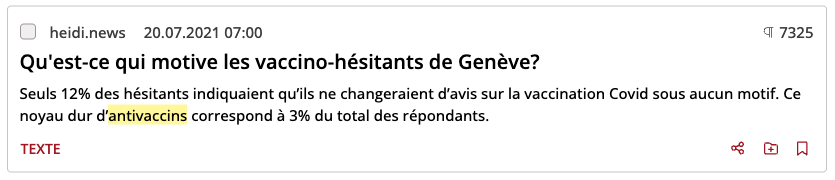



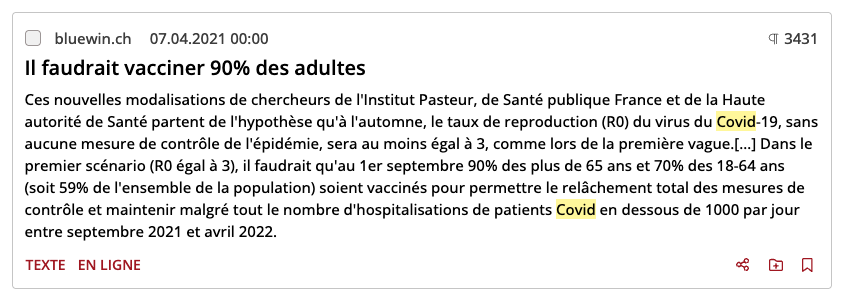




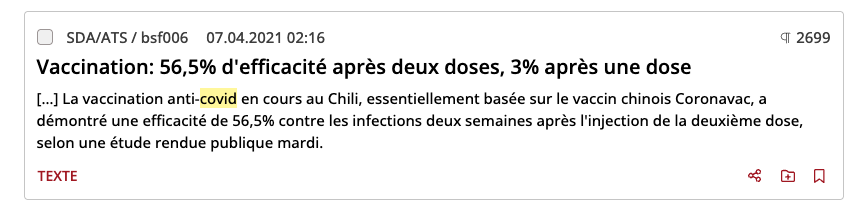





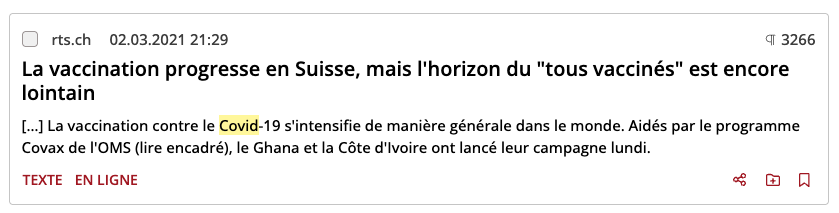





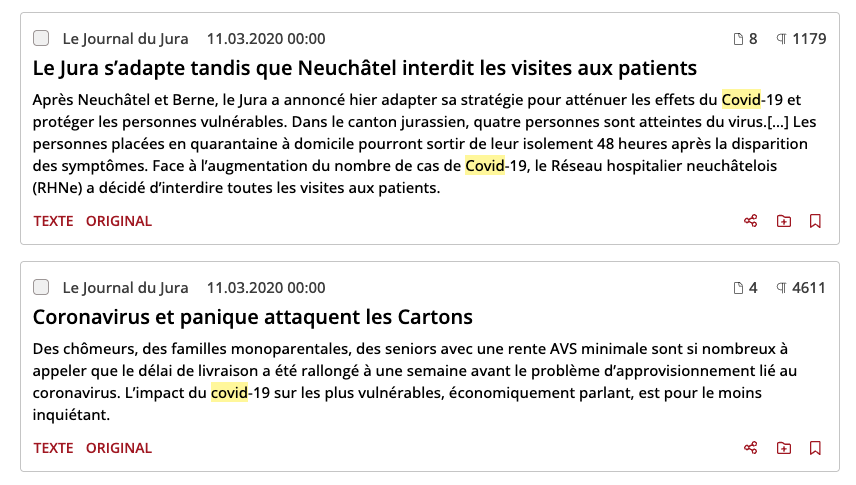









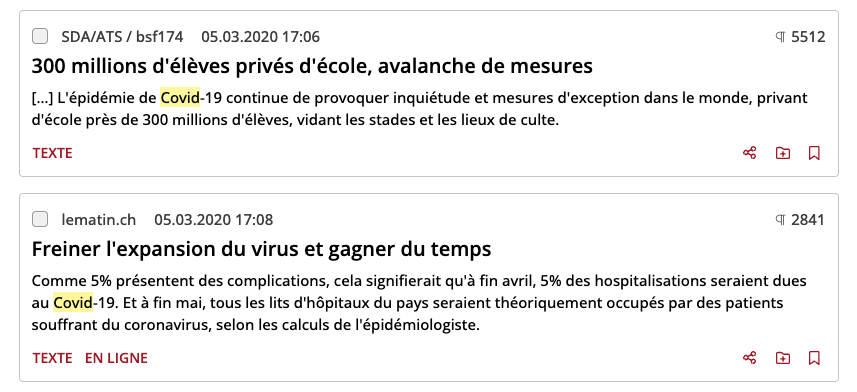


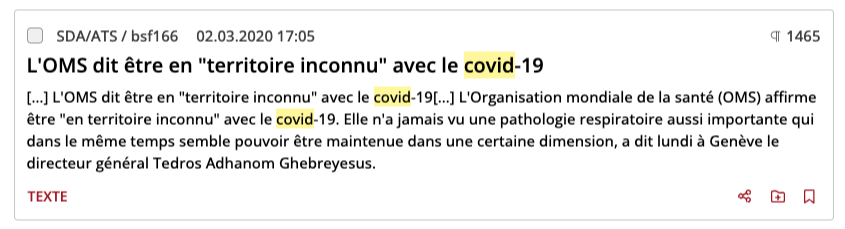


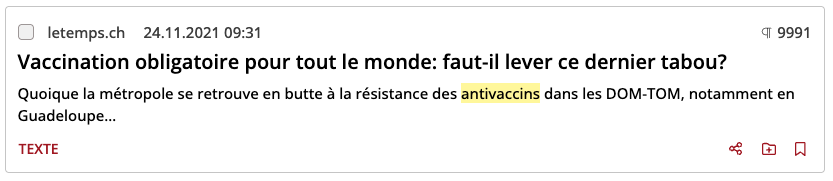
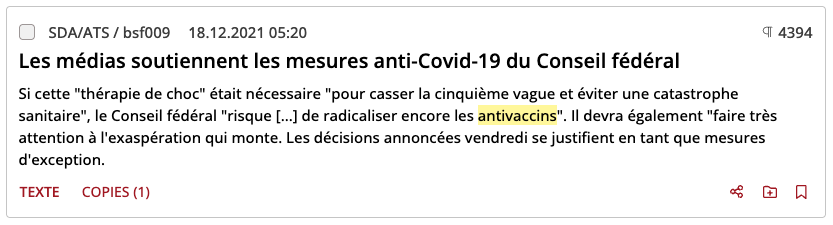

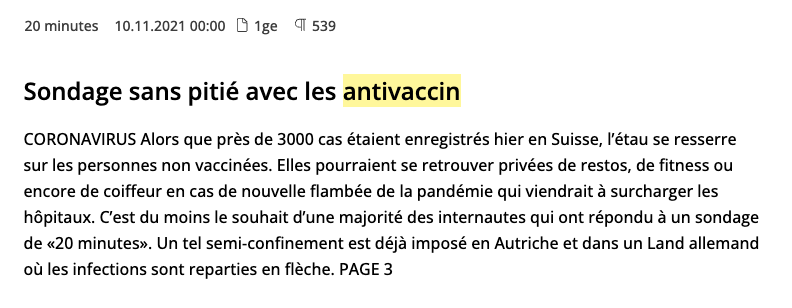















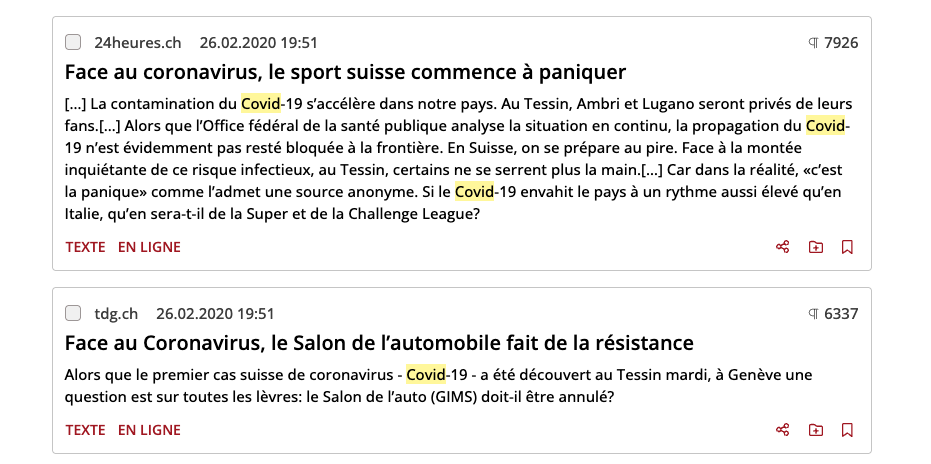









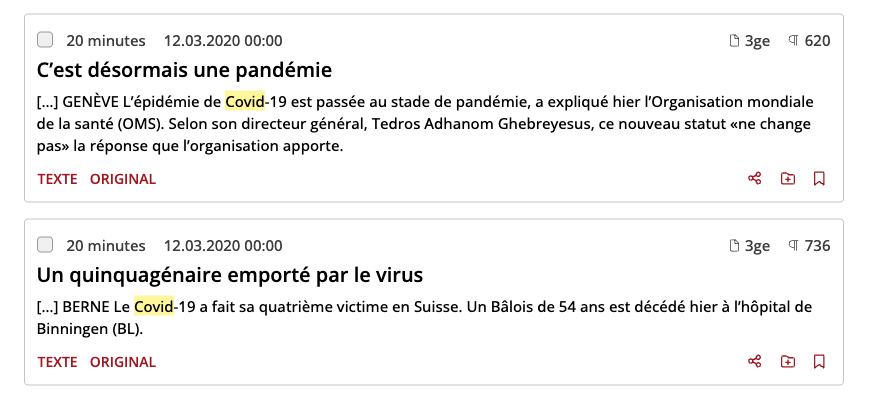







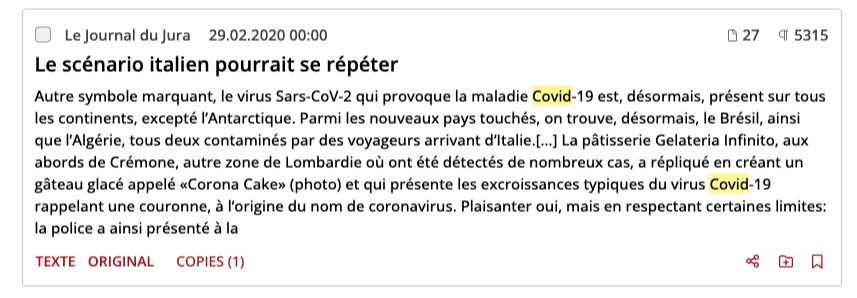


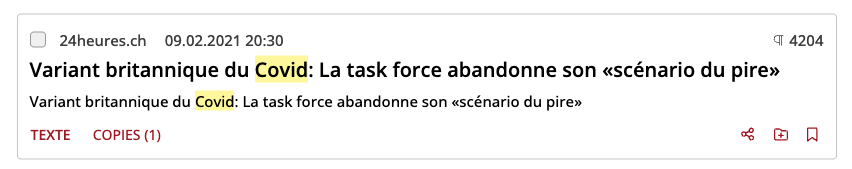
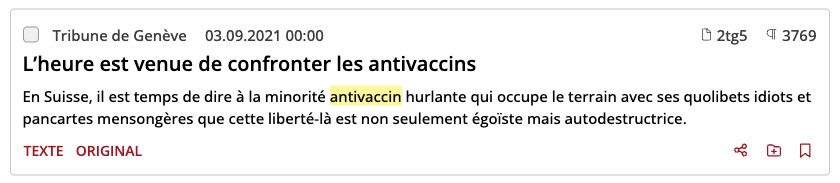
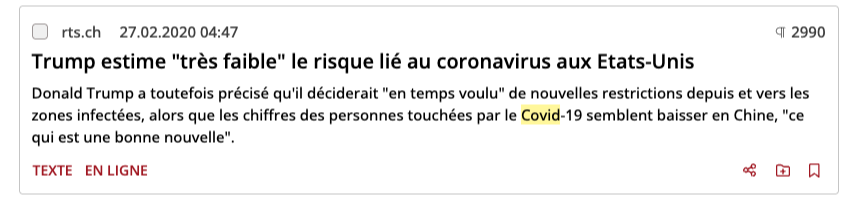
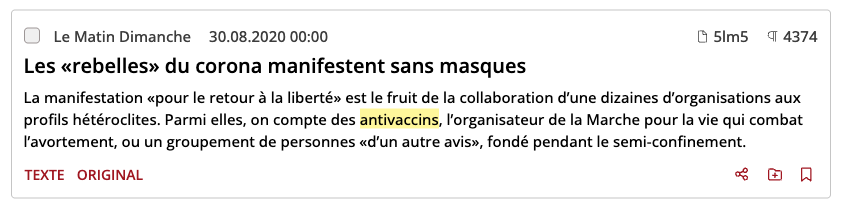




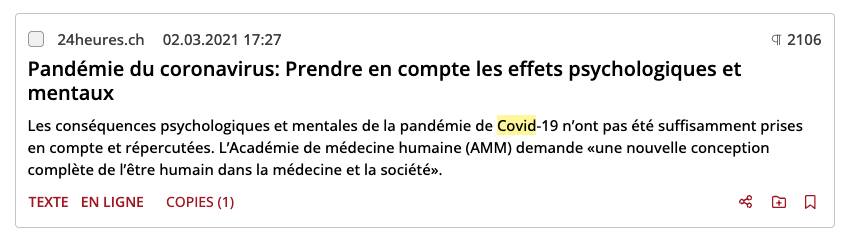
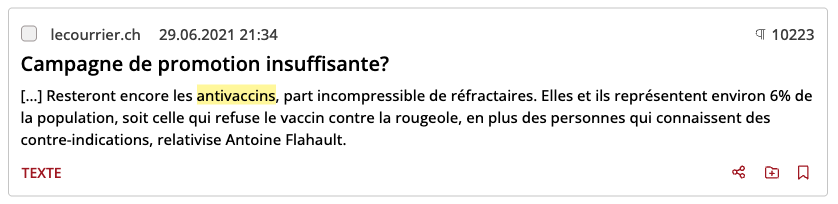

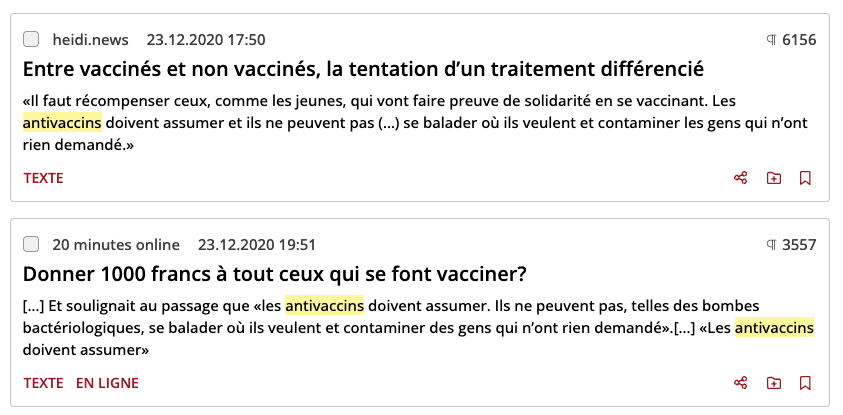

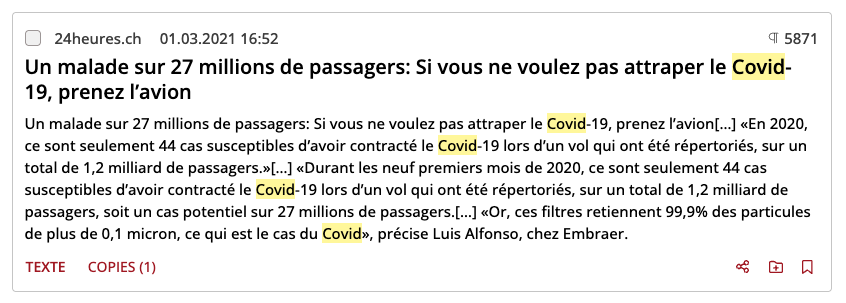
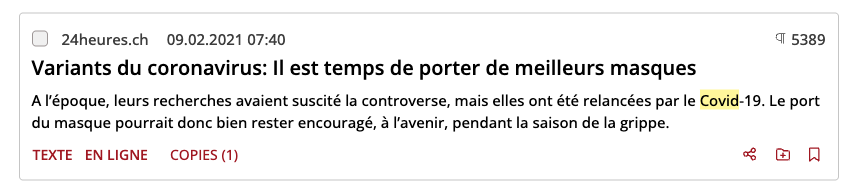


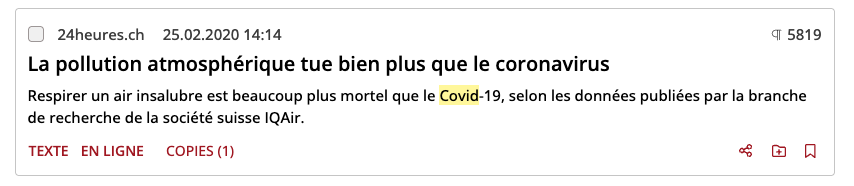
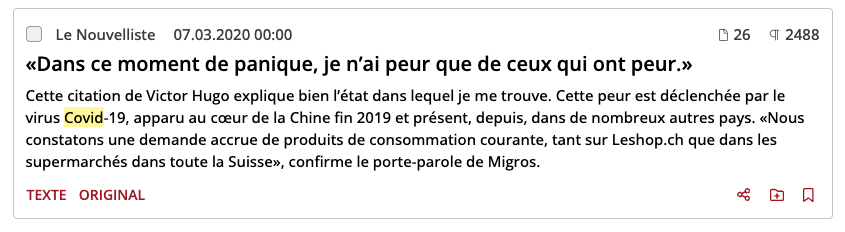


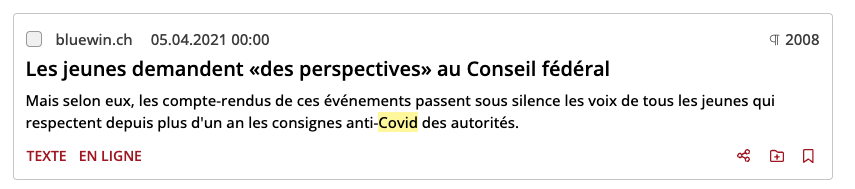

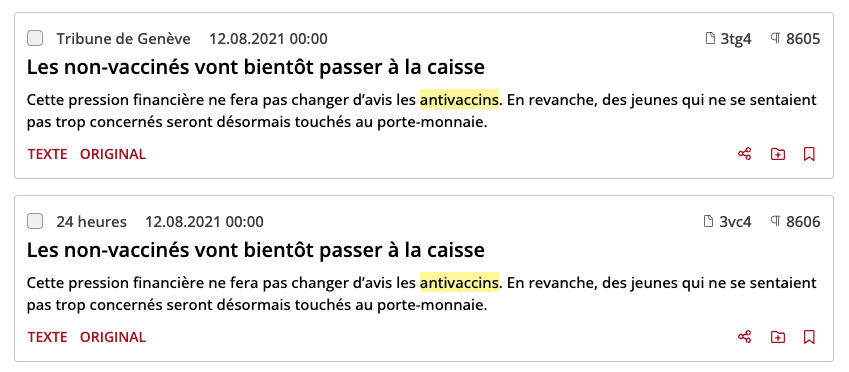
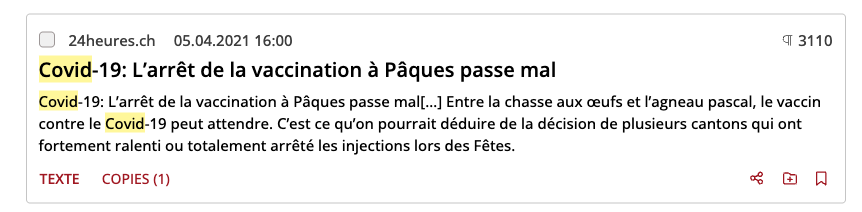

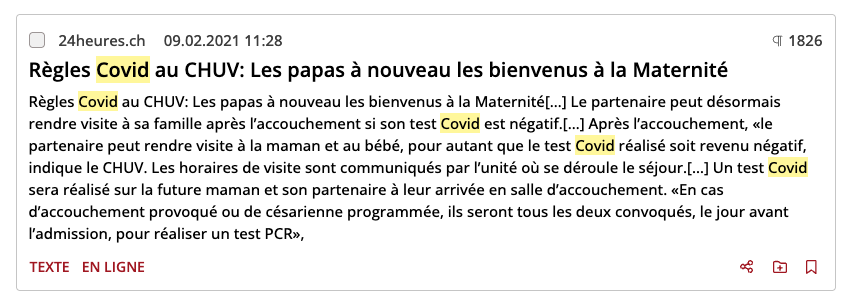



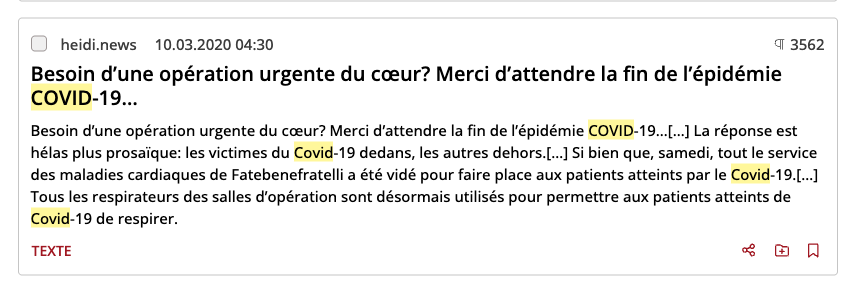





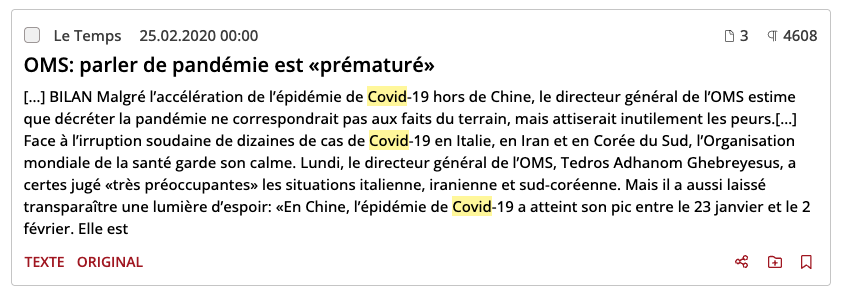
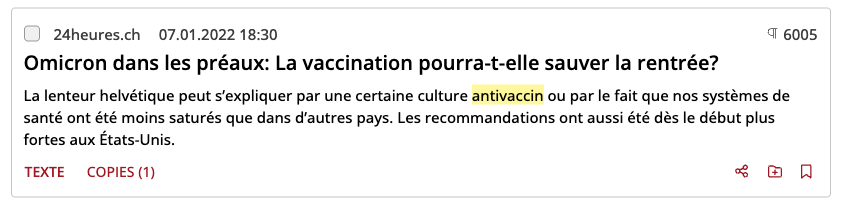






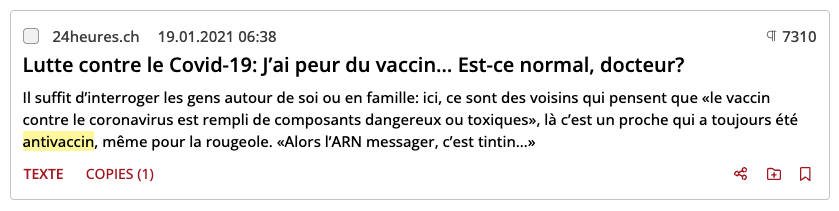





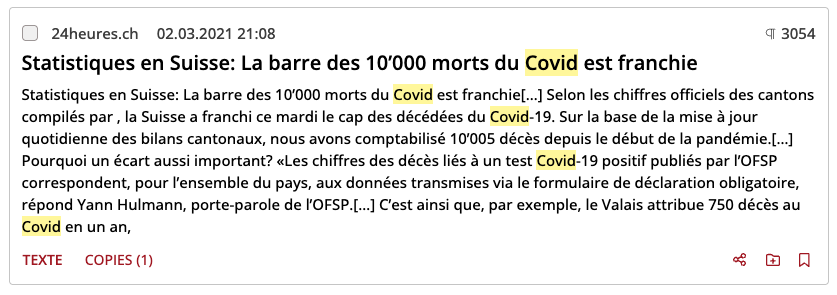

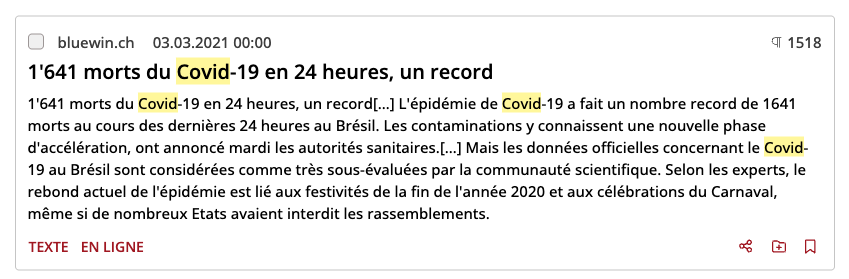





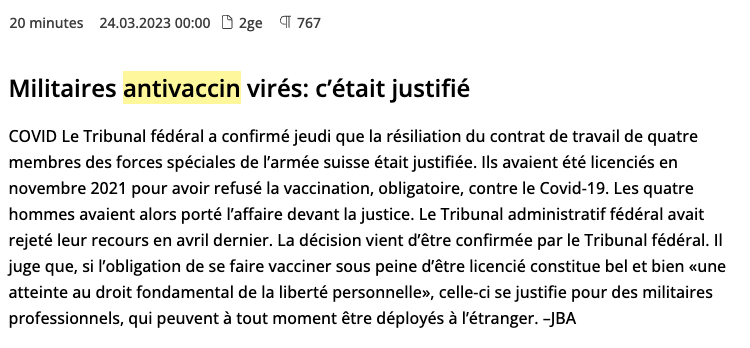
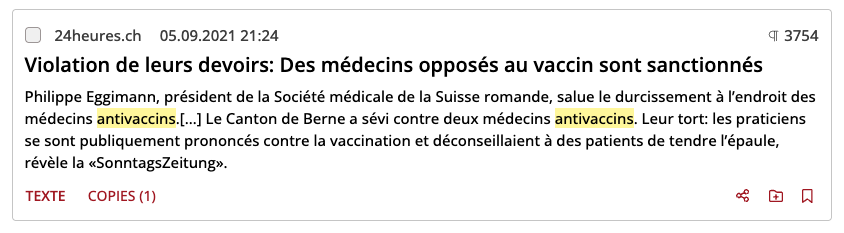

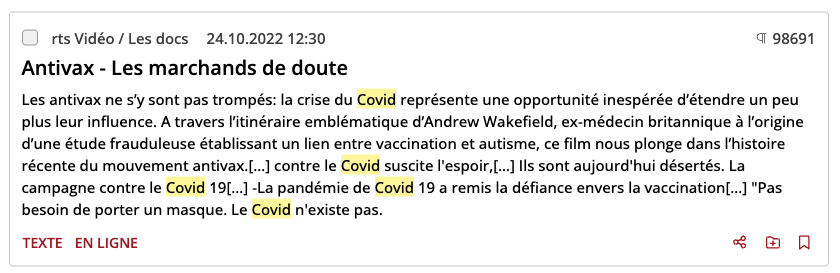


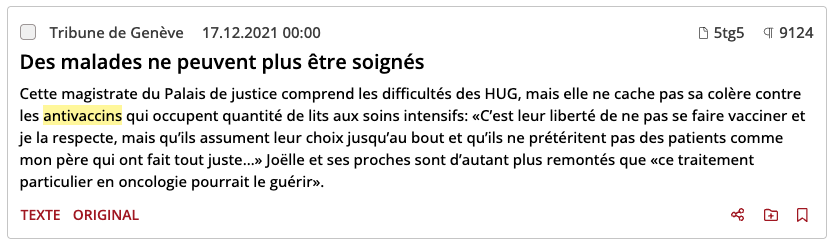

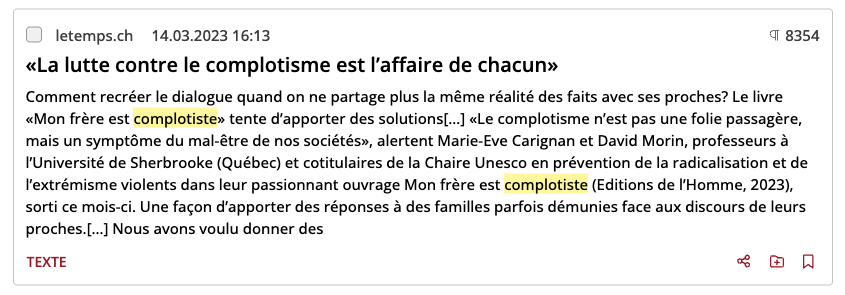

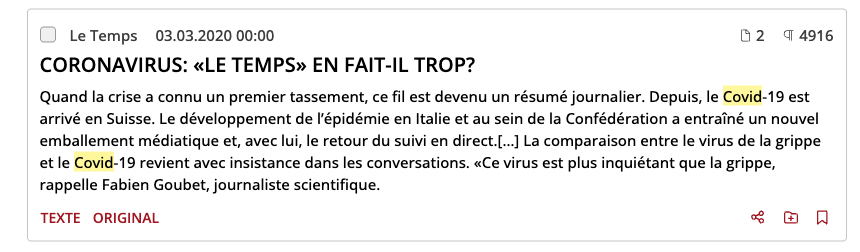

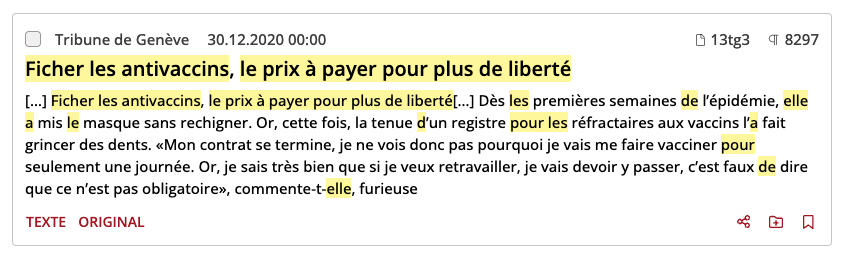

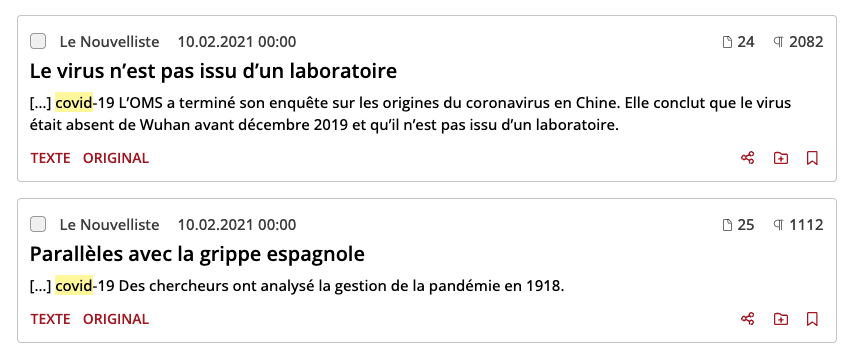



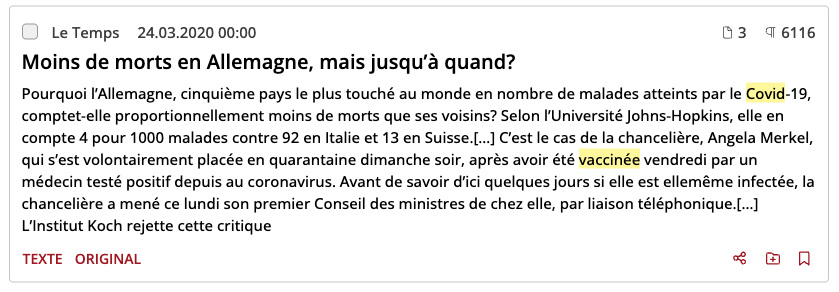
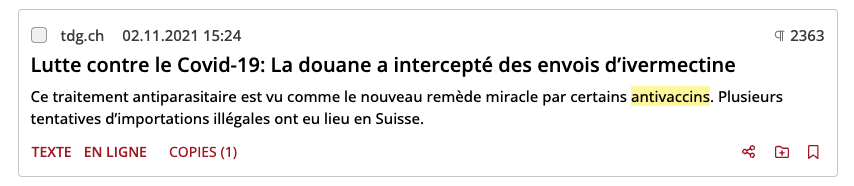

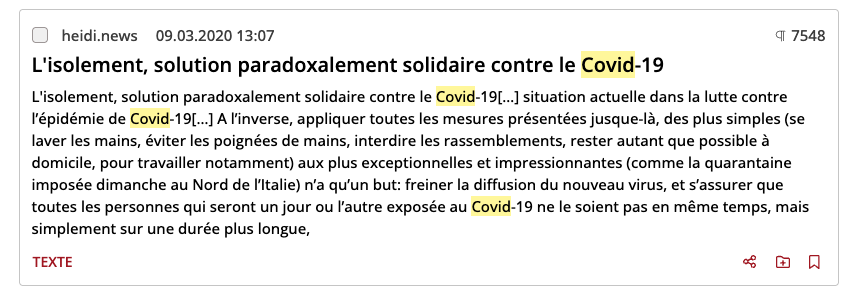
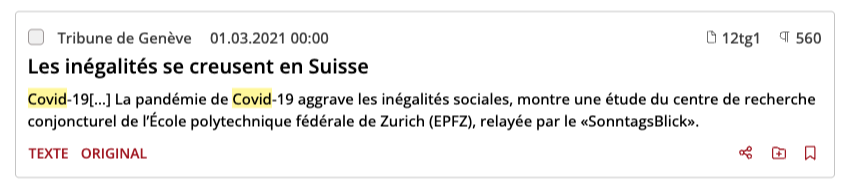
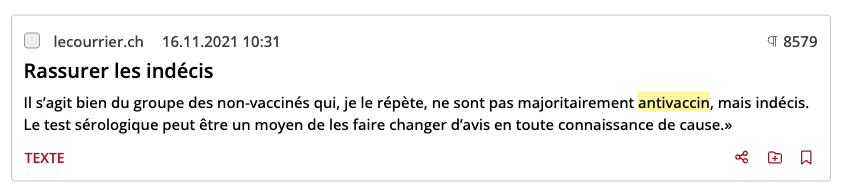

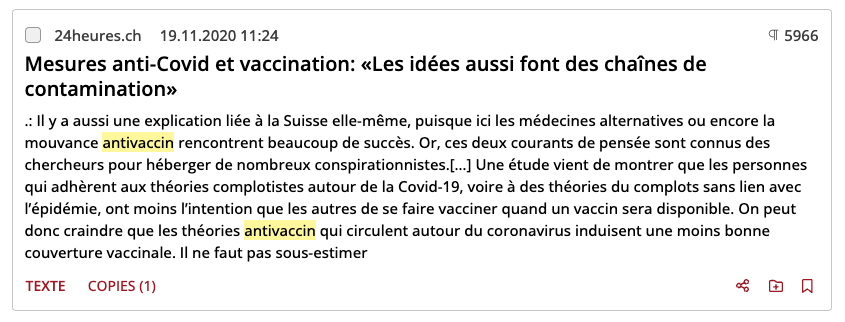

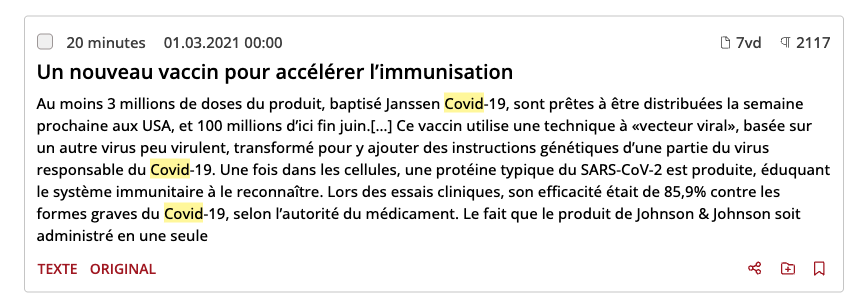



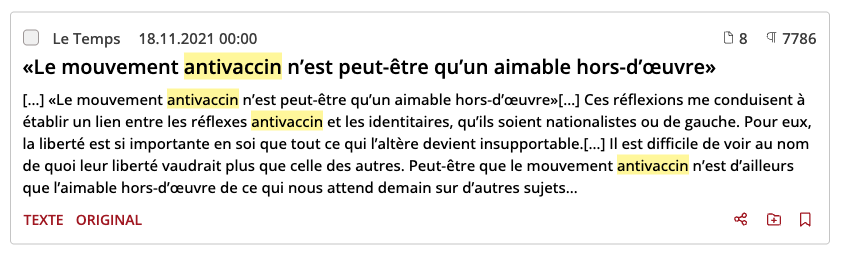



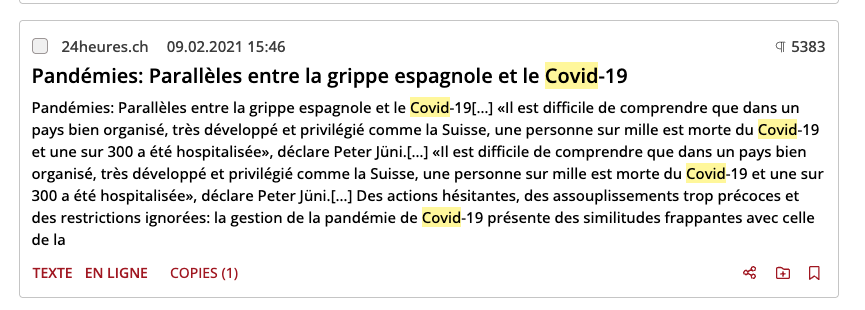

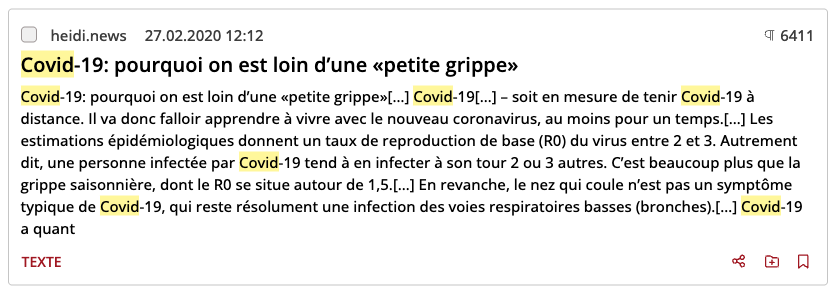
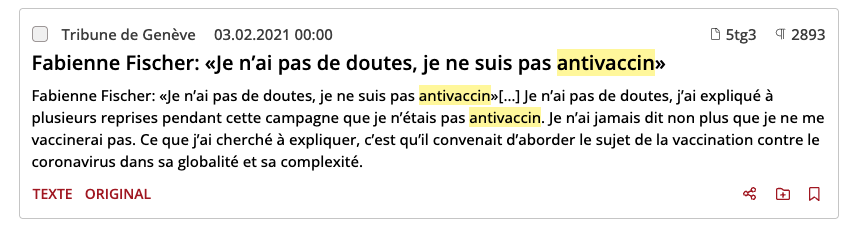

















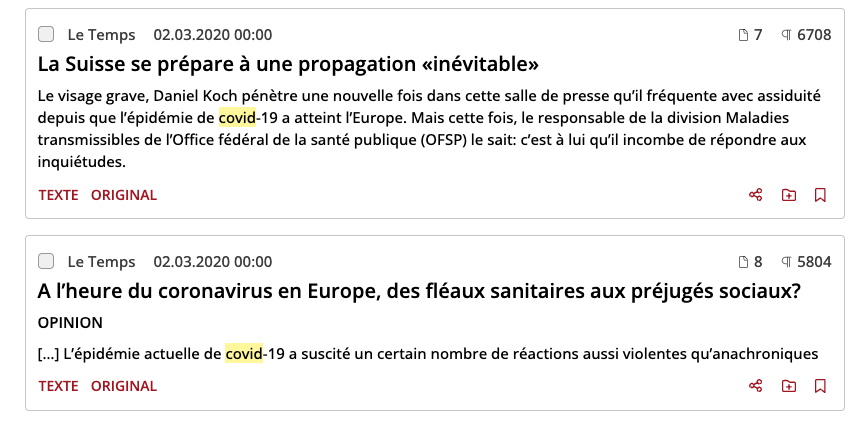



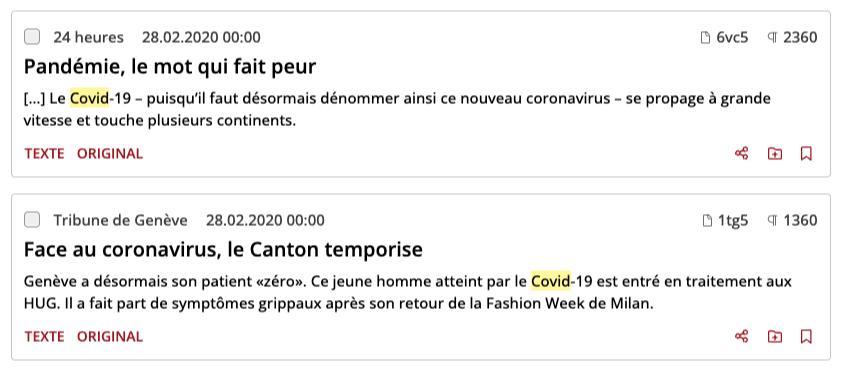












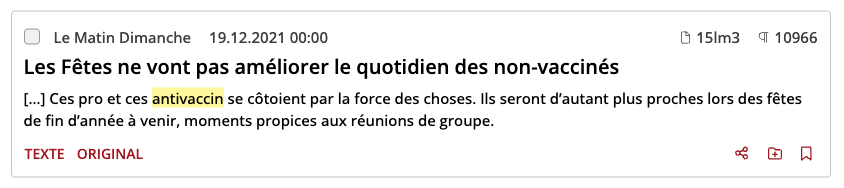





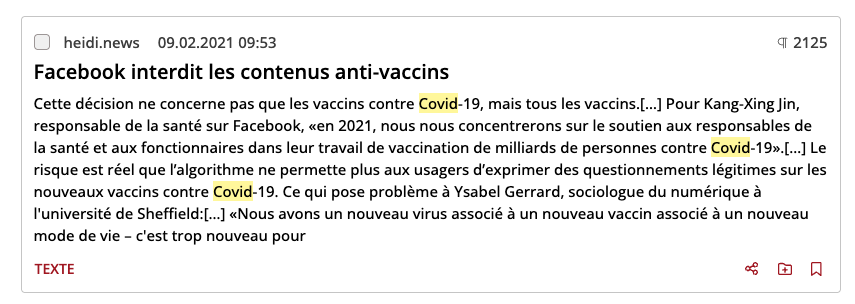

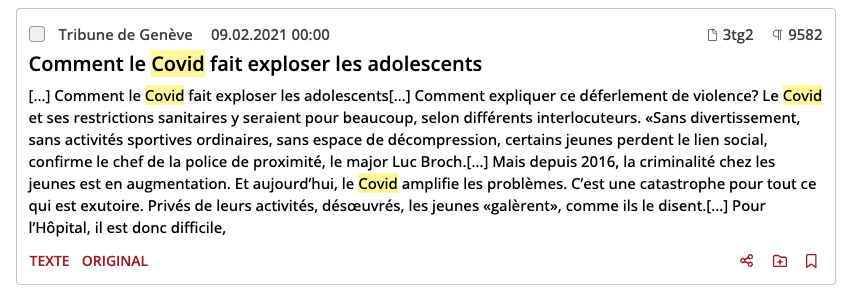
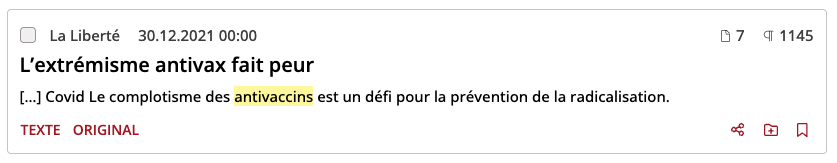

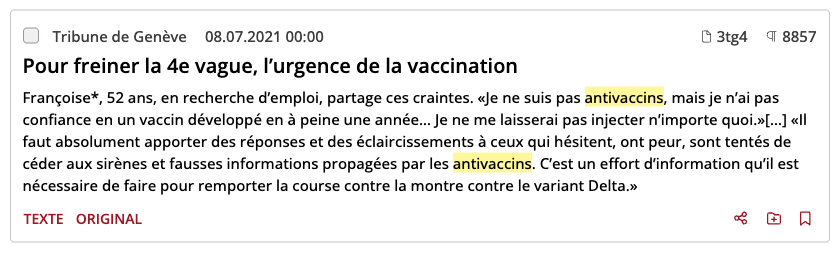
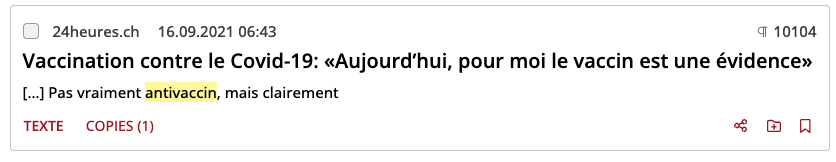


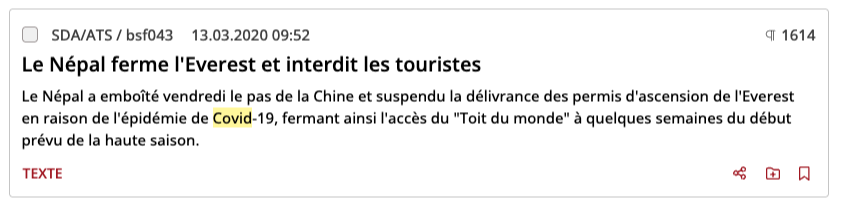
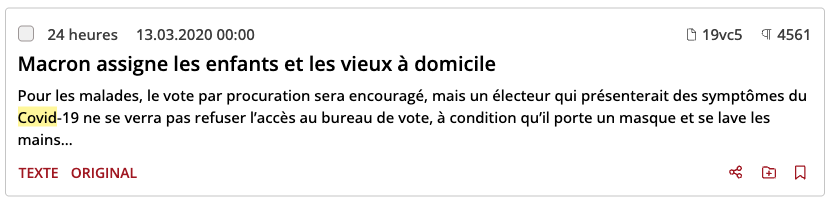














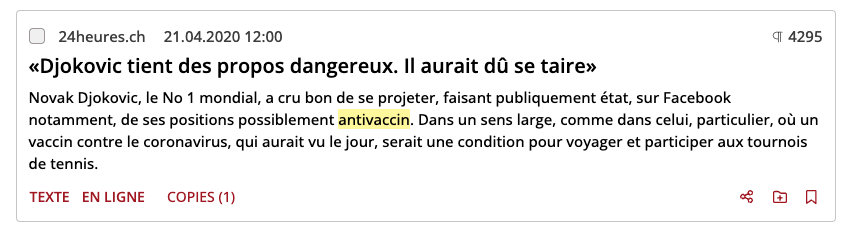
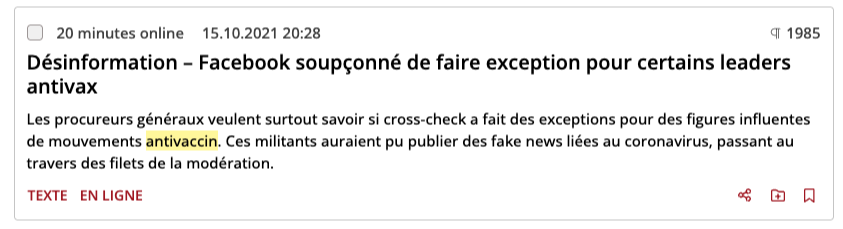

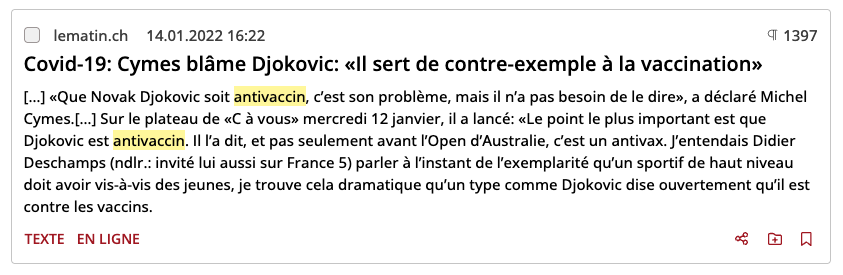



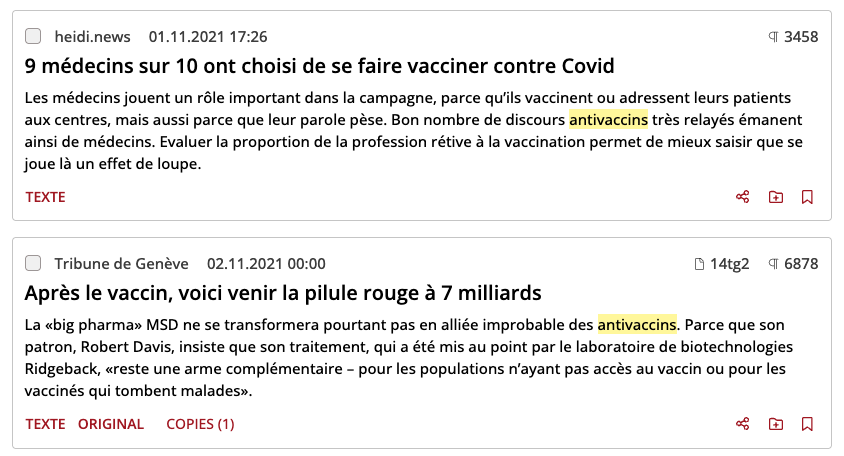
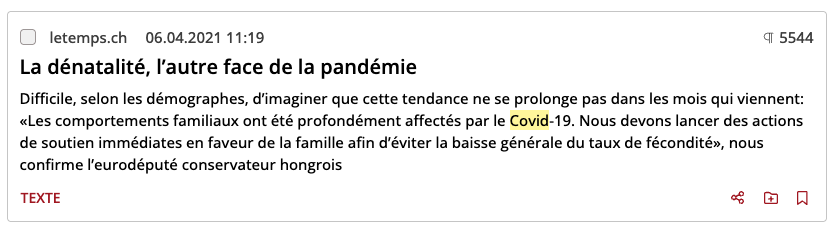
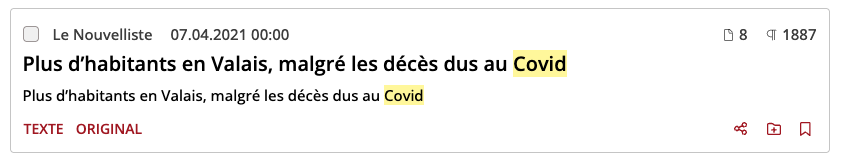
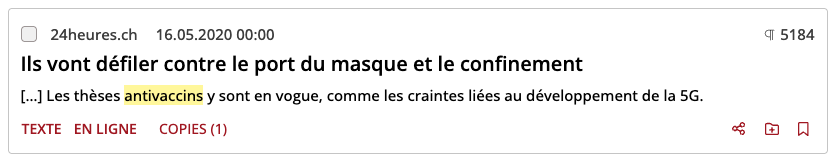

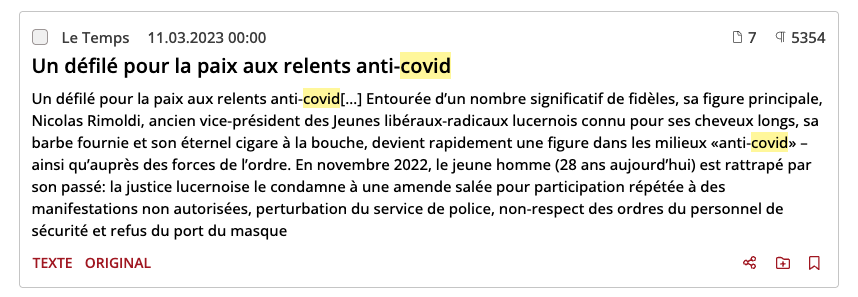

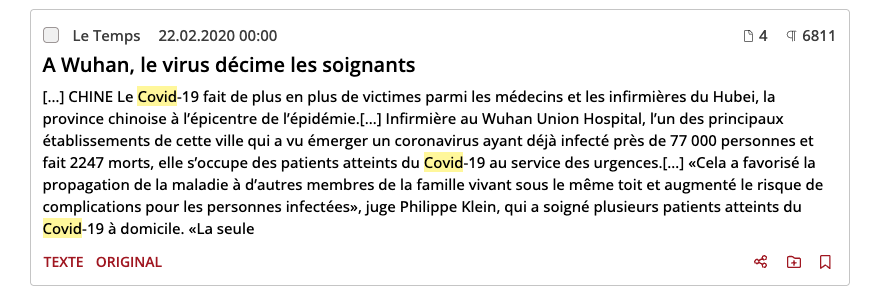

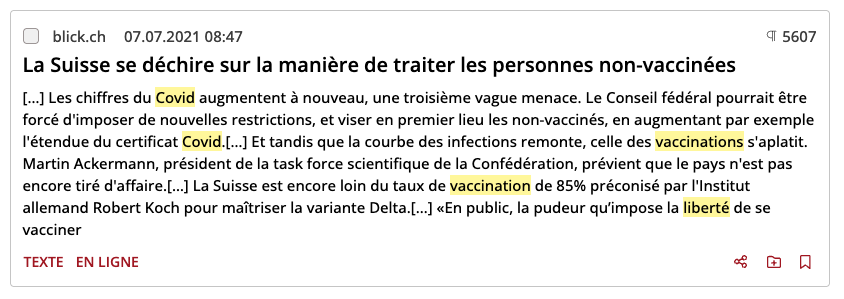



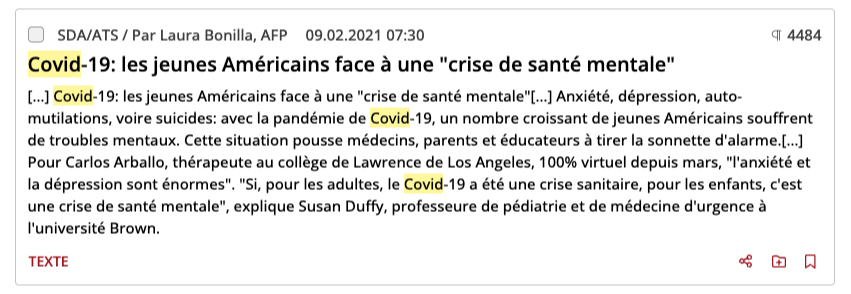


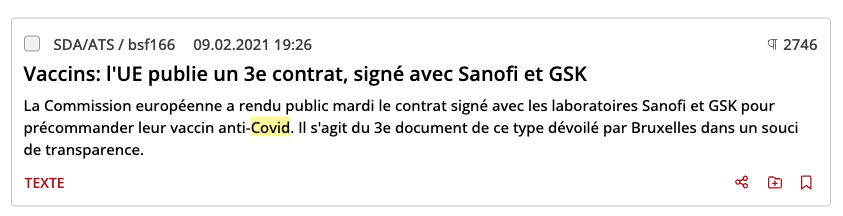
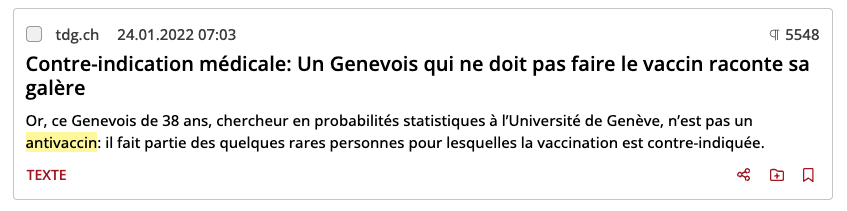



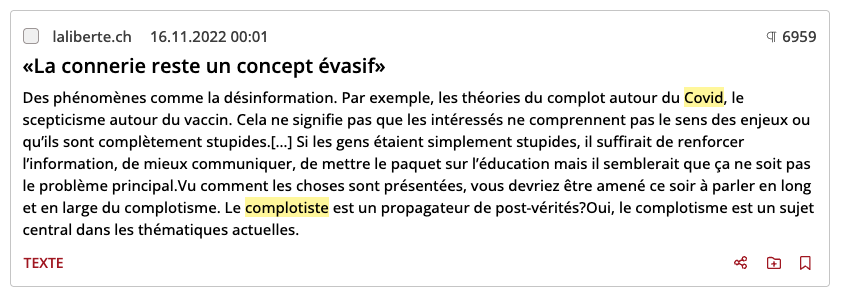

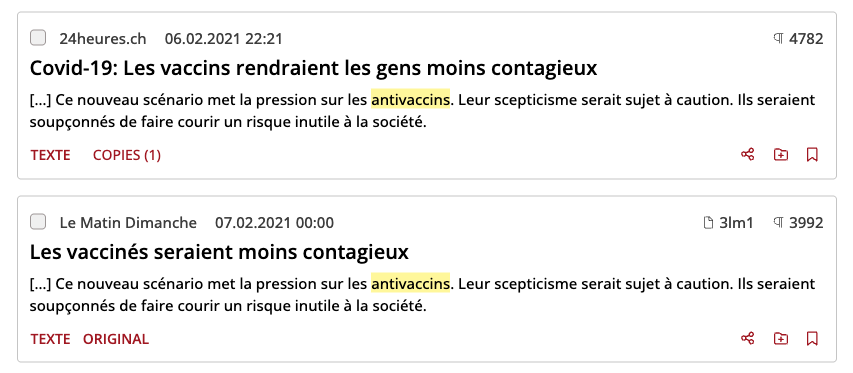











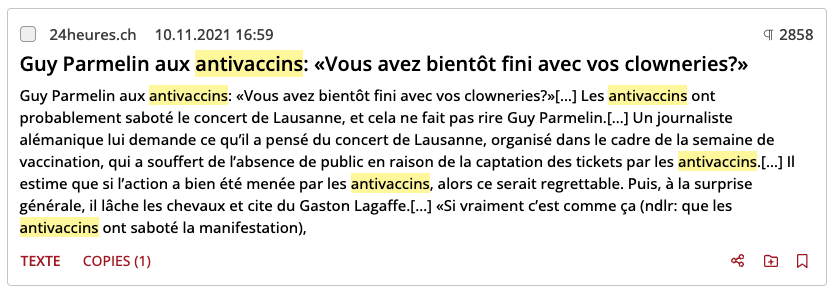

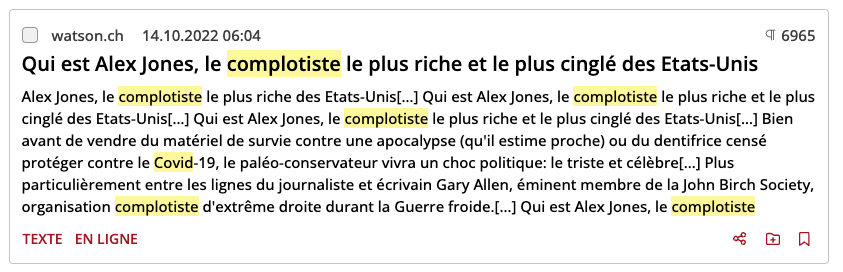



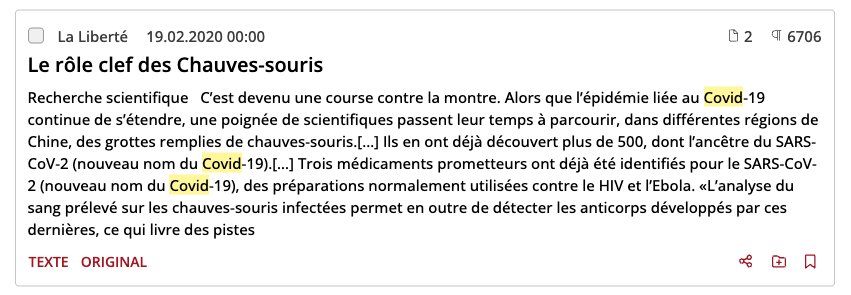

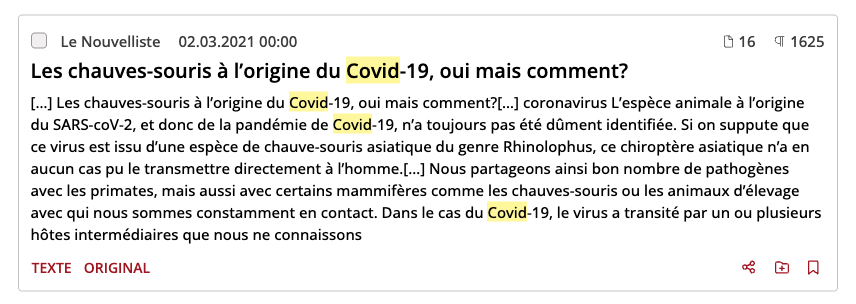
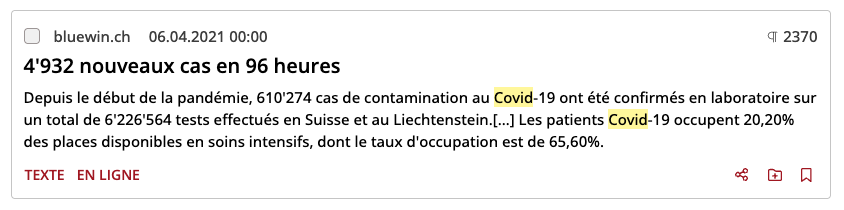
















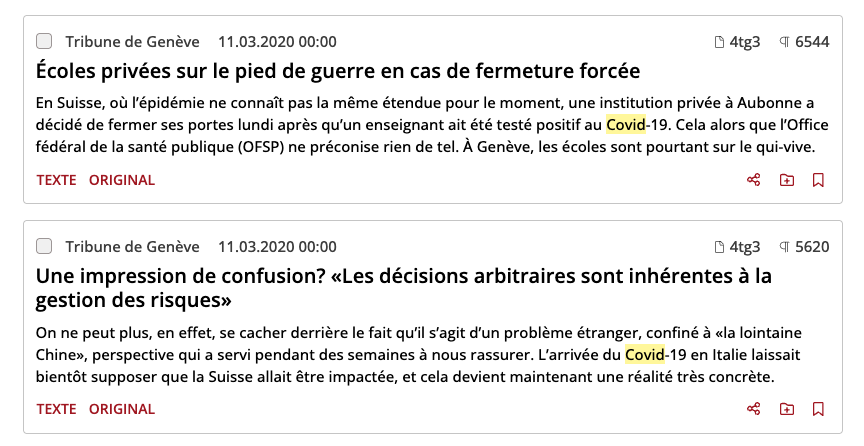









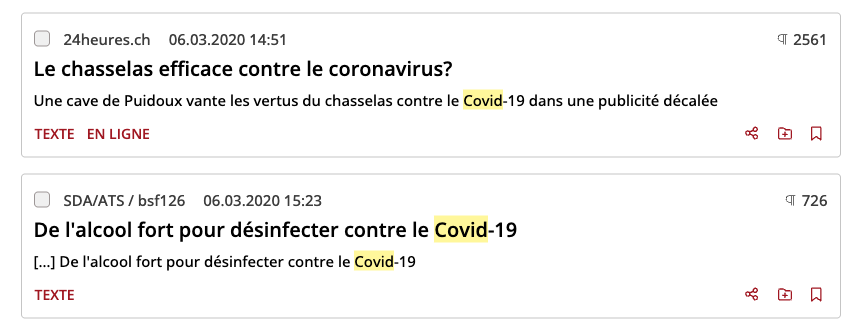





























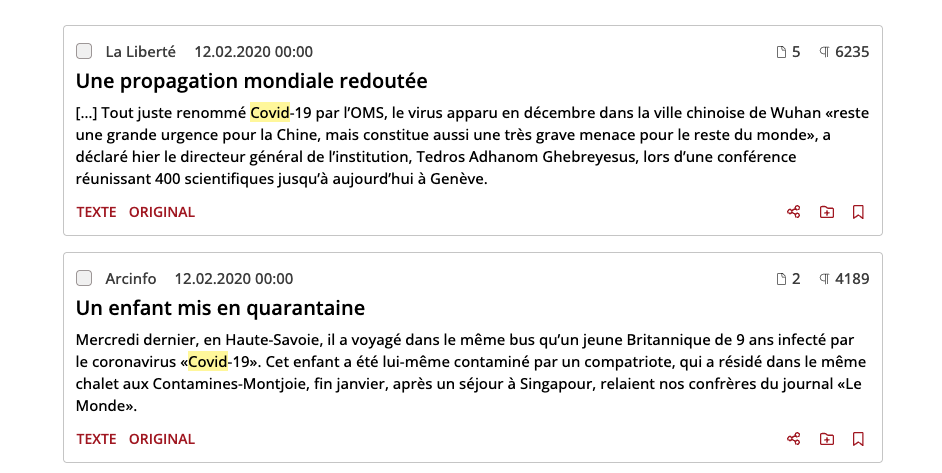


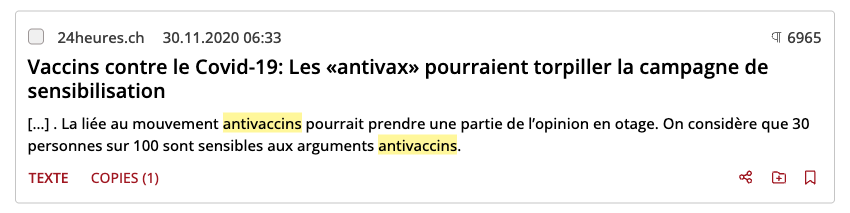
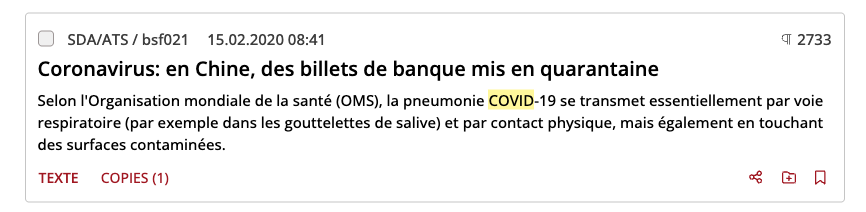



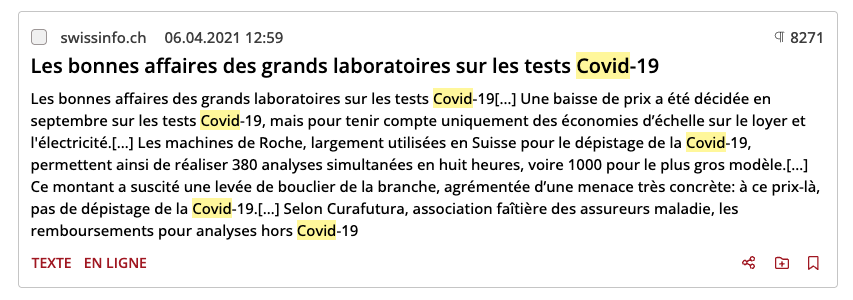





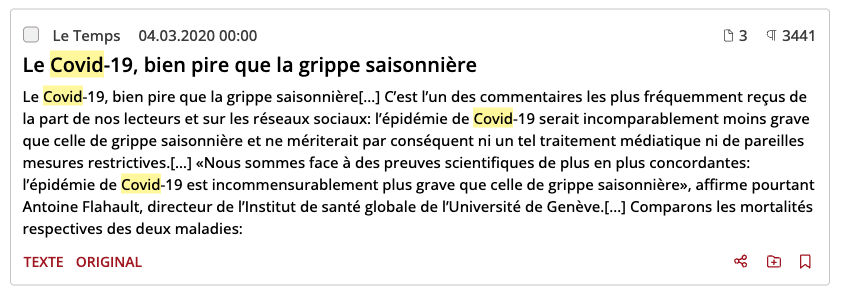

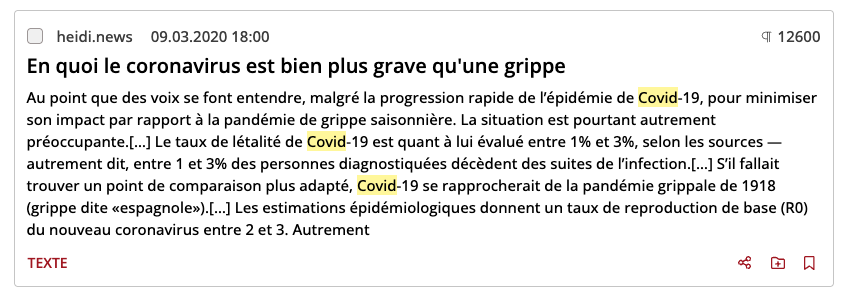



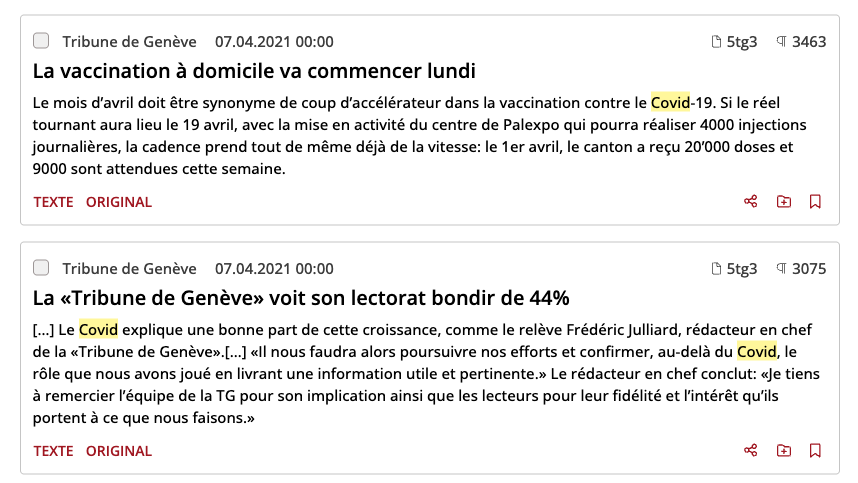

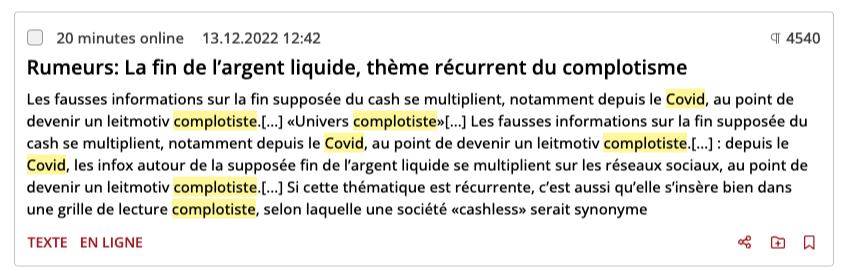

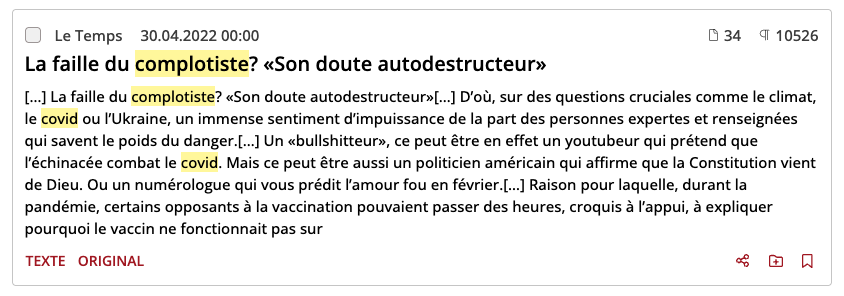




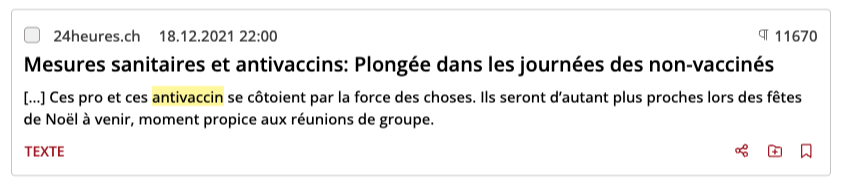


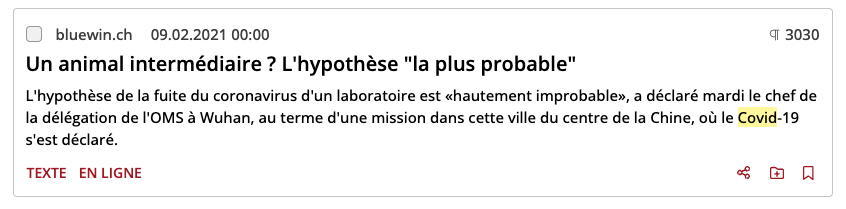
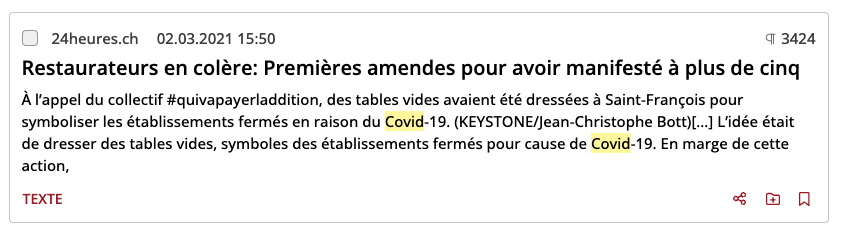
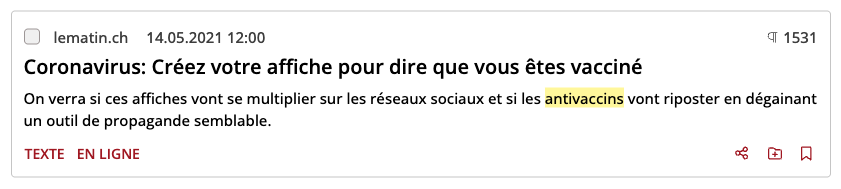
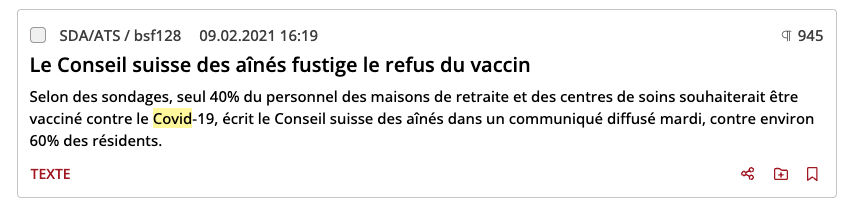
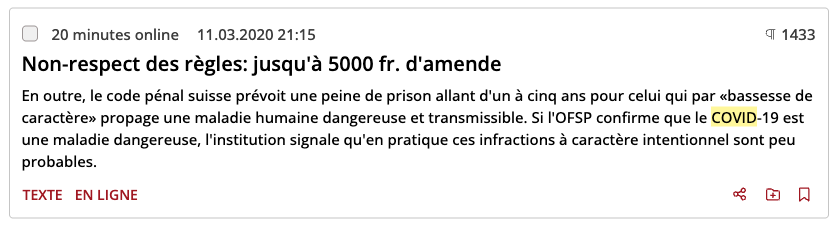

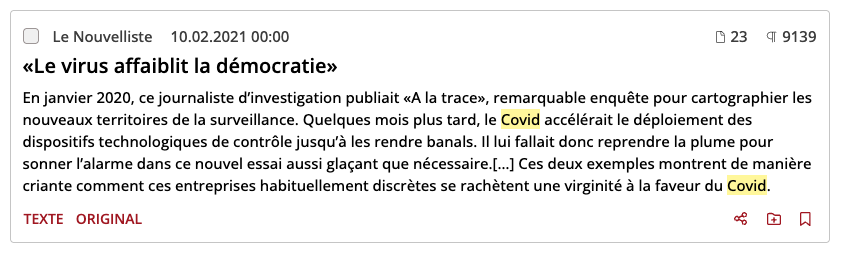
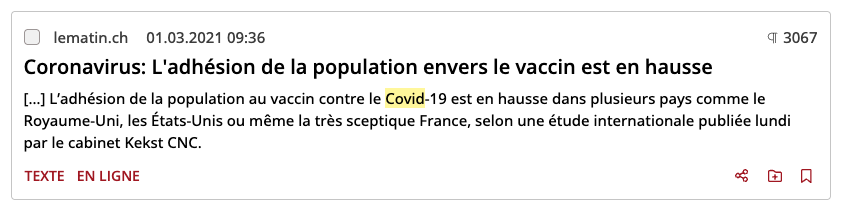
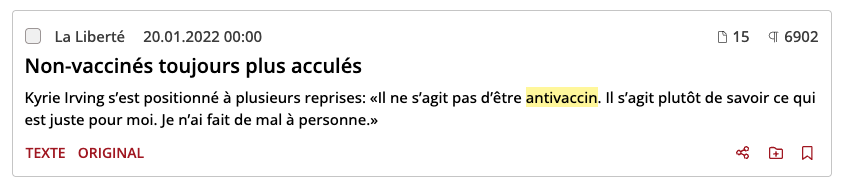





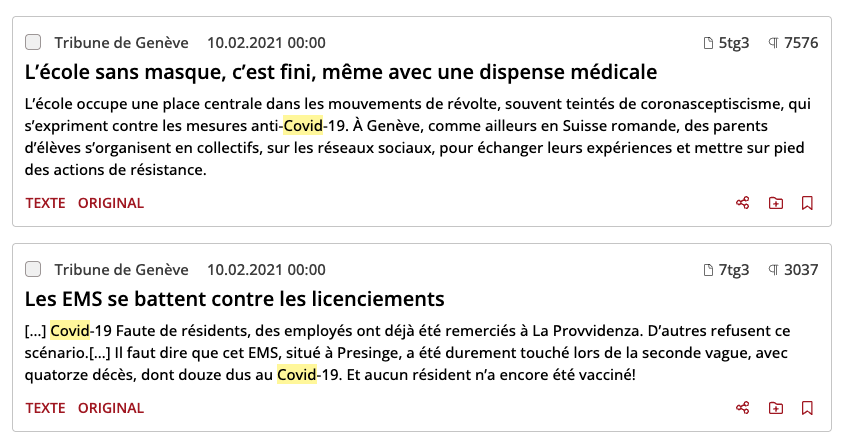

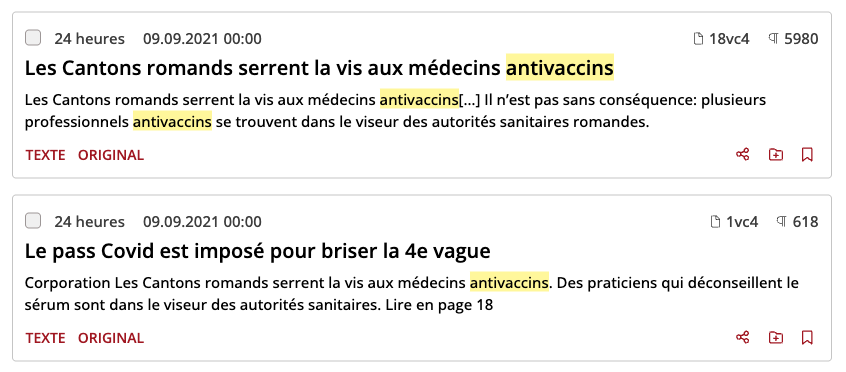

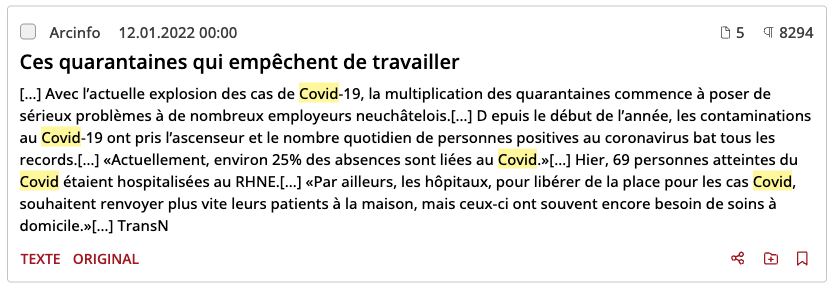
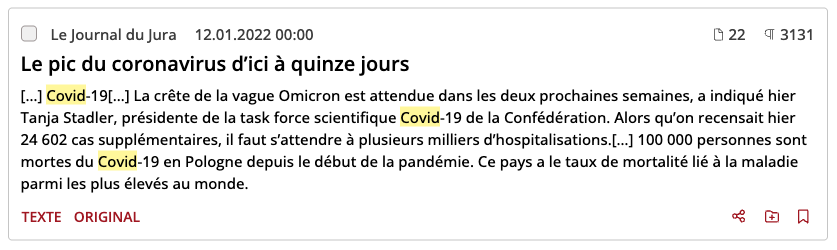

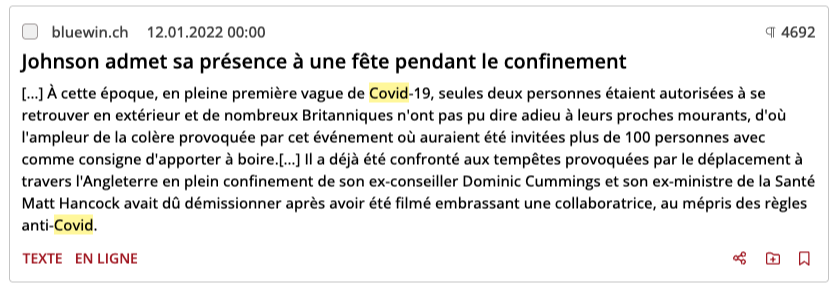

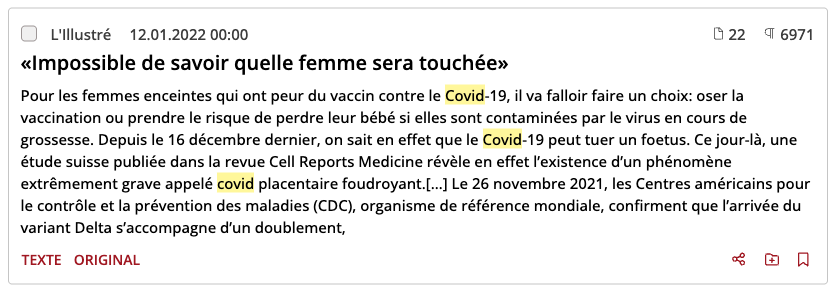

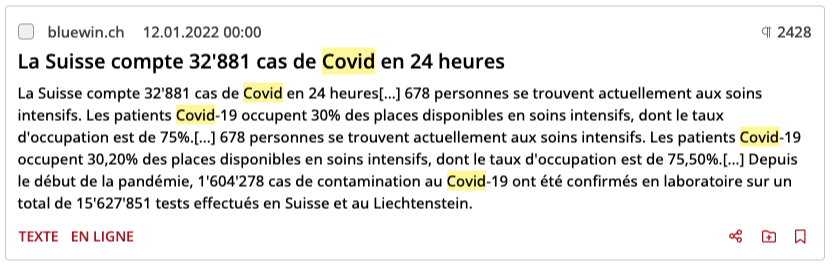


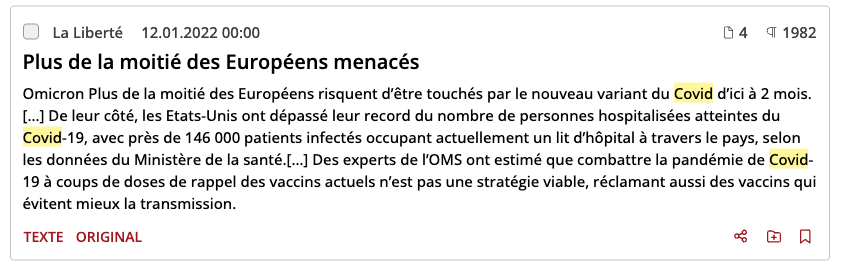

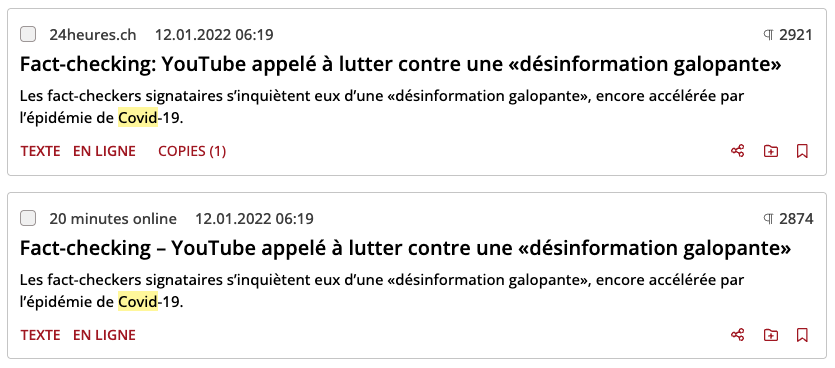



Merci beaucoup pour ce travail extrêmement sourcé qui pourra servir de base à d'éventuelles discussions. Par ailleurs, ce qui ressort, pour moi, et à l'issue de cette lecture, c'est le ravivement d'une blessure qui a beaucoup de mal à cicatriser tant nombre de personnes, de collègues, d'amis ont été odieux, ignobles et prêts à tout pour me nuire, nuire à la pensée, au questionnement et au libre arbitre. Le fait d'avoir été confronté à un comportement inhumain que j'avais uniquement étudié dans les livres me fait encore froid dans le dos et c'est un euphémisme...
Ni oubli, ni pardon !
Merci de ce rappel de l'incohérence (compréhensible parfois vu la nouveauté du virus ) et de l'atmosphère délétère qui régnaient pendant la pandémie.
Si les autorités (nationales et internationales) et les responsables de la santé (y compris les pharmas) voulaient bien une fois dire la vérité au sujet de cette pandémie, ils contribueraient à recréer une confiance dont la disparition dans le public menace la démocratie.
Bravo, excellente analyse. Je n'aurais pas faire mieux. Max F.
Malheureusement les 60% ont voté pour les mesures liberticides.
quoi faire quand l'esclave en redemande.
Bonjour,
Jamais je ne pardonnerai à ces idiots utiles de l'industrie pharmaceutique la façon dont ils ont fait de nous les bouc-émissaires d'une gestion de crise totalement défaillante.
Ils devraient avoir honte, finir dans les poubelles de l'histoire, ou alors changer de métier et faire quelque chose d'utile pour racheter leurs comportements fanatiques et discriminatoires (ce qui est un comble pour ces imbéciles bien-pensants qui n'ont que des mots comme "discrimination" à la bouche!!!).
Mais ils ne veulent rien voir, rien comprendre, ils sont dans un déni total.
Ces médias sont déjà en état de mort cérébrale mais ils survivent par un subventionnement artificiel au service d'un pouvoir politique devenu aussi imperméable à la réalité que l'ont été les pontes…